Texte et jeu Lauren Houda Hussein – mise en scène Ido Shaked – musique Hussam Aliwat – théâtre Majâz/Collectif et compagnie, au Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine.
C’est un triptyque dans lequel la mémoire collective croise la mémoire individuelle à travers l’histoire subjective écrite par Lauren Houda Hussein et portée à la scène par Ido Shaked. L’auteure et interprète se glisse dans la peau de son propre personnage avec flash-back dans le temps et projecteur sur sa jeunesse. Plutôt narratrice qu’actrice, elle raconte des bribes de son récit de vie, en écho aux drames récurrents objectifs qui émaillent son pays, le Liban, dans une région du monde on ne peut plus sensible et une géopolique depuis longtemps incertaine.
Les deux premières parties de cette histoire ont été écrites en 2021 et 2022 : dans la première, Beyrouth ou bon réveil à vous ! on voyage avec Lauren Houda Hussein au pays de son père, en 2006, à l’aube de ses vingt ans. La narratrice s’apprête à partir à Baalbeck assister au concert de Fayrouz, chanteuse libanaise emblématique qui a bercé sa jeunesse et que sa mère écoutait en boucle sur Radio-Orient, ainsi que sa consoeur Sabah, Oum Kalthoum l’Égyptienne, et Jacques Brel – dont on entend Ces gens-là (création sonore Thibaut Champagne). Mais à la veille du concert, le 12 juillet 2006, éclate à Beyrouth la guerre, nouvel acte du conflit israélo-libanais qui durera trente-trois jours, avec pour déclencheur, des tirs de roquettes et l’attaque du Hezbollah contre une patrouille de l’armée israélienne à la frontière. La narratrice fête ainsi ses vingt ans et son passage brutal à l’âge adulte. Les informations qu’elle suit à la télévision, à Beyrouth, le chef du Hezbollah parti se cacher dans les montagnes, la paix, un concept abstrait, composent son environnement. Elle apprend l’histoire familiale, celle du père, prince sans royaume et de ses sœurs dont l’une est en Syrie, la famille dispersée, en parallèle au contexte politique. Au Liban, même le chauffeur de taxi décrypte vos origines à partir du nom de famille, parmi les dix-huit confessions que reconnaît l’État. Certains s’enfuient, des bombes sont lancées sur les files de voiture. Elle, fait ses adieux à Beyrouth.
La seconde partie, Jérusalem, premiers pas sur la lune, nous mène de l’autre côté de la frontière, en Israël. Quelques mois après la guerre, alors qu’elle est à Paris et qu’elle apprend le théâtre, la narratrice tombe amoureuse d’un apprenti comédien, Hesse, Israélien. Et elle décide de partir avec lui voir l’autre pays, tant côté israélien que palestinien, le pays de l’autre contre lequel le Liban est épisodiquement en guerre. La voici coincée dans un conflit de loyauté et lâchée par son père qui pendant deux ans ne lui parlera plus. Le séjour commence par un interrogatoire serré à l’aéroport Ben Gourion. Elle rencontre la famille de Hesse, doit gérer sa culpabilité et manier la politesse avec virtuosité. Là-bas, les deux acteurs montent Roméo et Juliette, fort symbole. « Vous couchez avec l’ennemi » s’entend-elle dire. Pour elle Jérusalem est arrogante. Elle consulte une psychologue pour tenter de s’apaiser, parle de sa rencontre avec Tel-Aviv qu’elle n’aime pas, apprend à se méfier du moindre mot. Derrière la frontière, la Palestine occupée… À Tibériade, c’était l’abondance avant, et comme un paradis, lui raconte-t-on. Elle visite Saint-Jean d’Acre où elle regarde les oliviers, à perte de vue.
Là, elle commence à s’interroger, constatant que ce qu’elle avait vécu n’existait pas, que tout crie au vol ou à l’usurpation, que tout est orienté vers l’utopie d’un monde nouveau. Elle ne retrouve plus les villages que certains de sa famille ont habité. Alors, comment créer son propre récit ? En chemin, elle parle de l’enfant qu’elle attend et fait le constat d’un incommensurable fossé : « qu’allons-nous dire à cet enfant, est-ce que l’amour est suffisant ? » pose-t-elle. Elle révise dans sa tête le Dôme du Rocher, l’Esplanade des Mosquées, épicentres du conflit israélo-palestinien et bien d’autres sites, s’interroge sur le fantasme ou la réalité, comprend qu’il est temps de se dire au revoir.
Dans la troisième partie, Paris, oeil pour oeil dent pour dent, la narratrice reprenant l’écriture de son récit est envahie par l’image du père et règle ses comptes. Il sait qu’elle écrit son scénario avec à la base, son histoire, leur histoire. Pour pouvoir aller au bout du récit, elle place son père face aux formes de violence perçues dans l’intimité de la maison. « Il faut que je parle de ce que tu ne racontes pas » dit-elle. Et il évoque avec elle les oranges sanguines et le manguier de son frère qu’il leur apprend à arroser, l’olivier planté par le grand-père. « Je creuserai pour trouver la racine. Pour ne pas te ressembler » dit-elle, malgré l’admiration qu’elle nourrit envers lui. Et elle lui reproche tout ce qui a été mis sous le tapis, pour l’épargner peut-être. Il rappelle la guerre civile, elle se dédouane : « Je n’arrive pas à écrire parce que je t’épargne… Mais qu’est-ce que vous avez tous avec cette histoire de pardon ? » Le 4 août 2020, elle est à Marseille quand elle entend l’information sur l’explosion du port de Beyrouth. Le générique de fin arrive sur l’image d’un panneau de village, en Syrie et des brouillards, sur scène. « Tu fais quoi en Syrie ? – Je regarde la mer. »
Une histoire subjective du Proche-Orient mais néanmoins valide… je pense, construite en trois parties, nous fait traverser deux frontières et trois pays. La narratrice, Lauren Houda Hussein, en exil à Paris, y dessine le récit de sa vie, piégée dans les conflits interrégionaux et la violence autour de Beyrouth et Jérusalem. Sobrement vêtue de noir, elle est seule en scène et en occupe tout l’espace-avant, avec pour seul accessoire une chaise ; elle se déplace latéralement. L’absence de théâtralisation et le ton de la narration, posent question. Un musicien, Hussam Aliwat, placé sur une large estrade, en hauteur, la suit et l’accompagne au oud et au clavier. Il porte salopette, tee-shirt blanc et bonnet jaune. Chacun opère sur son territoire, les deux ne se rencontrent pas. Quinze projecteurs en fond de scène sont tournés vers le spectateur (création lumières Léo Garnier). Dans la seconde partie, des spots ronds surplombent le plateau, qui font penser à l’éclairage naturel du hammam.
Lauren Houda Hussein, auteure libanaise et Ido Shaked, metteur en scène israélien, ont fondé le Théâtre Majâz en 2009, à Paris. Leur premier spectacle, Croisades, texte de théâtre de Michel Azama, rassemble des comédiens français et du Proche-Orient. Il est joué en hébreu, arabe et français dans différentes villes d’Israël et de Palestine, avant de venir à Paris au Théâtre du Soleil, en 2011. Les Optimistes est le premier texte de la Compagnie, créé en 2012 au Théâtre du Soleil après une longue période de résidence à Jaffa en Israël, et a tourné pendant quatre ans. En 2016, la Compagnie crée Eichmann à Jérusalem ou les hommes normaux ne savent pas que tout est possible en co-production avec le Théâtre Gérard Philipe-CDN de Saint-Denis, puis elle crée à Toulon, en 2019 L’Incivile, en coproduction avec la Scène Nationale Châteauvallon-Liberté et le Théâtre Joliette à Marseille.
La troupe présente désormais son intégrale de Une histoire subjective du Proche-Orient mais néanmoins valide… je pense, dessinant sa cartographie entre Orient et Occident. Depuis l’écriture de ce texte la région s’est embrasée, davantage encore. Comme un bateau-ivre le Moyen-Orient est en feu. On tourne en rond dans la géopolitique. Mais qu’ont donc accepté les grands de ce monde en 1948, dans le partage arbitraire du Moyen-Orient et qui ne laisse aucun répit, nulle part dans le monde ?
Brigitte Rémer, le 3 janvier 2024
Texte et jeu Lauren Houda Hussein – mise en scène Ido Shaked – création musicale et interprétation live Hussam Aliwat – création lumières Léo Garnier – création sonore Thibaut Champagne. Les deux premières parties ont été créées au Théâtre de Châtillon, en novembre 2023.
Vu le 8 décembre 2023 en intégrale au Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, 1 place Jean Vilar/avenue de l’Abbé Roger Derry. 94400. Vitry-sur-Seine – tél. : 01 55 53 10 60 – en tournée : intégrales du 12 au 15 décembre 2023 au Théâtre Joliette, à Marseille – le 8 mars 2024 à 19h au Centre culturel Jean-Houdremont à la Courneuve – Le 26 mars 2024, au Théâtre Jean Lurçat, scène nationale d’Aubusson.












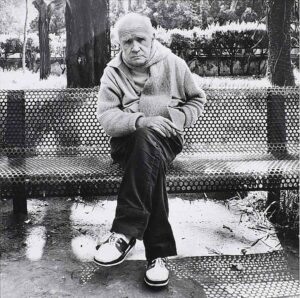


































































Vous devez être connecté pour poster un commentaire.