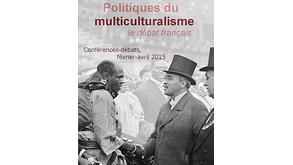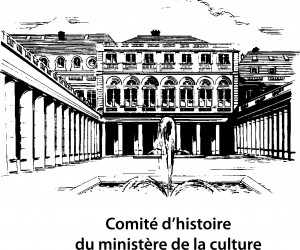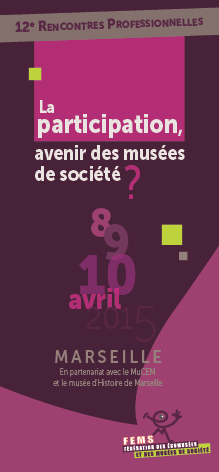Un colloque organisé par la Commission nationale française pour l’UNESCO en partenariat avec le Conservatoire National des Arts et Métiers s’est tenu le 8 septembre 2016 au CNAM.
Un colloque organisé par la Commission nationale française pour l’UNESCO en partenariat avec le Conservatoire National des Arts et Métiers s’est tenu le 8 septembre 2016 au CNAM.
Les représentants de la communauté scientifique française et internationale, les délégations permanentes auprès de l’UNESCO et les représentants de la société civile étaient invités à débattre autour des propositions relatives à la révision de la Recommandation de 1974 de l’Unesco concernant la condition des chercheurs scientifiques, élaborées par la Commission française pour l’UNESCO. Son Président, Daniel Janicot, le Secrétaire général de l’Association internationale Droit, Ethique et Science, Christian Byk, la Directrice de la Recherche au CNAM, Clotilde Ferroud et la Directrice de la Division de l’Ethique, de la Jeunesse et des Sports à l’UNESCO, Angela Melo, ont ouvert la journée. S.E. Laurent Stefanini, Ambassadeur et Délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO l’a clôturée, évoquant le projet de création d’un observatoire mondial qui permettrait d’assurer le suivi de la Recommandation.
Quatre sessions furent proposées au cours de tables rondes qui ont introduit aux débats : La science globale, un défi pour les chercheurs – La responsabilité sociale du chercheur scientifique – La condition du chercheur – Egalité et accès à la reconnaissance.
La rencontre concernait les chercheurs du domaine privé (les plus nombreux) autant que ceux du public – près de huit millions de chercheurs dans le monde d’après le dernier rapport UNESCO, paru en 2015 –. Elle a mis en exergue l’intégrité et l’éthique du chercheur, la nécessité du travail en équipe, l’intérêt de donner la parole à la société civile et de mettre à sa disposition les avancées des chercheurs. Elle a parlé du rapport à la connaissance, de propriété intellectuelle et de bien public, de publication et de monopole.
Elle a évoqué les conditions de travail du chercheur et d’un juste salaire souhaité, de l’inégalité du traitement entre hommes et femmes, des disparités entre les régions, de la liberté de recherche en vis à vis à la problématique de subordination hiérarchique, du temps qu’il faut à la recherche, de la nécessité d’accompagner les jeunes chercheurs à partir de la fin de leur thèse, de la fuite des cerveaux.
Elle a posé la question de devoir prêter serment devant ses pairs, comme le médecin s’engage dans ses fonctions en prononçant le Serment d’Hippocrate. Ce point a prêté à de vigoureux échanges. Evoquant la crise de confiance à laquelle la recherche fait face de manière récurrente, la responsabilisation des Etats et des décideurs est reconnue comme essentielle afin de dégager les moyens nécessaires. La création d’un fonds mondial pour la recherche, dans cet objectif, a été grandement évoquée.
La Recommandation de 1974 est aujourd’hui dépassée et incomplète, le chercheur idéal et idéalisé tel qu’elle le décrivait, n’existant pas. D’où l’intérêt de ce colloque visant à réviser le texte, une excellente initiative pour préparer l’étape suivante.
Brigitte Rémer, 14 septembre 2016
Twitter : CNFUnesco// Facebook : CommissionNationaleFrancaiseUnesco – www.unesco.fr – Soundcloud : CNFU // Youtube : Commission Nationale Francaise pour l’UNESCO – Ministère des Affaires Étrangères et du Développement International, 57 Boulevard des Invalides – 75007 Paris – Tél : 01 53 69 39 55.