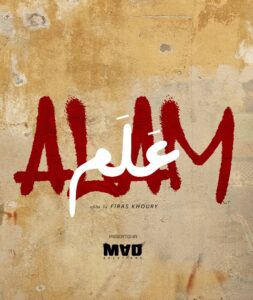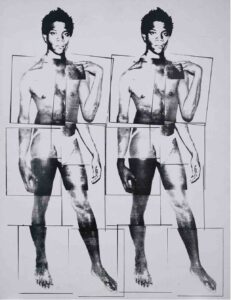J’aurais aimé être en Égypte – Rétrospective des photographies de Nabil Boutros – Centro Atlántico de Arte Moderno/CAAM, Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas – Commissariat d’exposition Katerina Gregos.
Dans le quartier historique de Vegueta, la vieille ville de Las Palmas, se trouve le Centro Atlántico de Arte Moderno/CAAM, un bâtiment du XVIIIème siècle restauré par le grand architecte espagnol Francisco Javier Sáenz de Oiza, inauguré en 1989. La maison mitoyenne, administration du Musée, remonte au XVIème, sa porte en pierre sculptée témoigne du syncrétisme des styles musulman, gothique et renaissance. On pénètre dans ce bâtiment lumineux comme sur le pont d’un navire, l’Atlantique au bout de la rue. Des passerelles d’acier, des rampes et traverses, un sol de marbre, tout y est blanc immaculé. Dirigé par Orlando Britto Jinorio, le Centro Atlántico de Arte Moderno est un lieu magique de rencontre entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique, en même temps qu’un lieu de fierté locale qui a construit en son centre un espace clos, évoquant un patio à la manière des maisons de Las Palmas. À travers Ojalá estuviera en Egipto, Nabil Boutros nous apostrophe et montre son travail photographique le plus significatif, vingt-cinq ans de ses travaux réalisés de 1997 à 2023. Un temps recomposé en dix séquences.
Artiste plasticien franco-égyptien vivant et travaillant entre Paris et Le Caire, Nabil Boutros a montré son travail, principalement tourné vers l’Égypte et le Moyen-Orient, dans des manifestations internationales, des institutions culturelles et des galeries privées. Le Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas l’invite à présenter une rétrospective de son œuvre, ici majoritairement photographique, art auquel il s’est consacré depuis la fin des années 80. Chaque série, chaque thème a été présenté séparément dans le cadre d’expositions collectives, à Paris, au Caire, à Alexandrie, et dans bien d’autres villes. Nous les avons vues et commentées au fil des ans, depuis l’année 2005*. Même si une œuvre en solo parle et se suffit à elle-même, la notion de rétrospective – pour Nabil Boutros une première – met en lumière les différents calques, couches et strates de l’œuvre dans son ensemble. Elle amplifie le geste artistique, démultiplie les visions, montre l’évolution de la pensée philosophique et sociologique qui sous-tend la démarche de l’artiste, son appropriation des techniques, les mouvements et variations de son parcours.
Après des études aux Arts-Décoratifs du Caire, puis aux Beaux-Arts de Paris, Nabil Boutros a débuté avec la peinture. La photographie intervient dans son œuvre à partir de la fin des années 80, noir et blanc-tirages argentiques, puis couleur-prises de vue en numérique. Il réalise aussi des scénographies d’expositions on ne peut plus poétiques, consacrées aux enfants, dans les bibliothèques, crée la lumière de spectacles de théâtre, croise le travail d’écrivains, réalise des installations multiformes, dans de nombreux pays. La constante de son travail et son fil d’Ariane touchent au regard qu’il pose sur l’Égypte, son pays d’origine, regard qui fluctue selon les événements, l’épaisseur de la colère, sa quête d’identité. « Je crois que, désormais, je n’ai envie de photographier que l’Égypte… » disait-il dans une interview à Souâd Belhaddad en 2003, alors qu’il reconnaît ses sentiments paradoxaux et ambigus par rapport au pays, qu’il avait quitté à l’âge de vingt ans.
De retour, à partir des années 90, ses déclarations d’amour à l’Égypte se gravent, sous différentes formes, avec une partie de la mémoire du pays, qui s’envole. Il entreprend pendant sept ans un travail sur les Coptes du Nil, (1997-2004) – l’une des plus anciennes chrétientés remontant au Ier siècle après J.C. née à la suite de la prédication de l’évangéliste Marc – dont le CAAM présente cinq séries, dans une pièce intime et protégée. Lui-même issu d’une famille copte, il en montre les rituels et le quotidien et compose très librement des montages de trois ou quatre photographies de tailles différentes, mêlant noir et blanc avec couleurs, pour raconter l’histoire autrement, selon sa sensibilité et sa perception des pratiques :
jeux d’ombres, flottements de lumière et envols de robes et tissus noirs, réverbérations dans divers monastères dont celui de Gabal El Teir à Minya et ceux du Wadi Natroum. « L’identité copte est un héritage plus que millénaire et son ancrage dans la terre de l’Égypte est total. Les mois coptes par exemple, sont un héritage direct des mois pharaoniques, les plus justes de l’antiquité, conçus au rythme du Nil, de l’agriculture et des saisons. Les paysans s’y réfèrent encore aujourd’hui » écrit-il. Ce travail avait été entre autres présenté aux Vèmes Rencontres de la Photographie Africaine/Bamako 2003 sur le thème Rites sacrés/Rites profanes et avait prêté à la publication en 2007 d’un imposant ouvrage de référence, Coptes du Nil, entre les Pharaons et l’Islam ces chrétiens d’Égypte aujourd’hui, sur un texte de Christian Cannuyer, offrant ainsi un morceau de cette terre d’Égypte ! comme il aimait à le dire.
Dans une seconde pièce, aussi intime et jouxtant la première, le CAAM présente la Série Le Caire-Alexandrie, (1998-2004). Nabil Boutros avait entrepris une longue série de portraits d’Égyptiens en respectant un protocole particulier : à la tombée de la nuit, quand le temps se suspend, il cherche les lieux habités, une permanence dans son cheminement, « lorsque la vie cesse d’être éblouie par le soleil » dit-il. La nuit délivre sa part de mystère et de divin, parfois la part d’obscurité de l’homme. Au Caire, des amoureux sont sous un pont, un homme passe devant un panneau publicitaire, deux femmes attendent un autobus ; à Alexandrie, ville de villégiature, la mer tient le rôle principal, dans les cafés on joue à la taoula ou aux dominos, Edouard Al-Kharrat y a vécu et écrit entre autres La Danse des passions et Alexandrie, terre de Safran. Le Centre Culturel Français d’Alexandrie a exposé ces séries d’ombre et de lumière en avril 2005. Le clair-obscur fait penser à Rembrandt. « La photographie a quelque chose à voir avec la résurrection » dit le philosophe Roland Barthes.
Autre regard sur l’Égypte porté par Nabil Boutros et qui n’est pas sans dérision, L’Égypte est un pays moderne, réalisé en 2006 sous l’égide du Centre culturel français d’Alexandrie et du Goethe Institut. Autour de ce concept de modernité, la présentation se fait ici en six séries de deux photos de même format posées côte à côte, et de six séries où se juxtaposent un petit et un grand format. GlobaLocal s’intitulait à l’origine l’exposition où le regard de Nabil Boutros, dans son art du détail, raconte avec humour et provocation ce qui lui saute aux yeux dans les bonnes intentions et paradoxes de la vie égyptienne, ses constructions, son modernisme débridé et un peu kitsch. L’obsession du pays est bien là, dans ses traumatismes et son intranquillité. Dans cette même immense salle du CAAM, un mur fait référence à la guerre, sous le titre Un Voyage de printemps (2014). Six photographies dont le point de départ est comme une belle carte postale : la photo d’un quartier, d’une felouque sur le Nil, de la Côte Nord près d’Alexandrie, un paradis perdu où les balles ont dégradé le paysage et les explosions semé incendie et terreur. Collées directement sur le mur, ces photographies gravent la confrontation Israël/Palestine. Les cadres sont bordés d’une calligraphie en arabe classique, peut-être quelques sourates. Dans ce même espace se trouve une installation de cartes à jouer géantes, intitulée Tentative pour construire des pyramides aujourd’hui (2023). Entre arrogance et représentation du pouvoir, papier peint collé sur carton poker menteur avec chiffres et dessins dissimulés vers l’intérieur, parfois en rébus ou en miettes. La barbarie y côtoie l’atout cœur.
Plus loin, sur la main courante d’une des passerelles du CAAM, Nabil Boutros nous regarde à travers vingt-quatre autoportraits de sa série Égyptiens ou L’habit fait le Moine, (2011). Il s’est grimé et mis en scène, interprétant les rôles de l’Égyptien moyen : un mimodrame où il est un parfait musulman avec la tabaâ – marque ostensible de sa piété, un voyou du coin de la rue, un pope chez les coptes, un homme d’affaire, un sportif, ou encore un Saïdi de Haute Égypte, avec ou sans moustache, avec ou sans barbe, il a le regard de la Joconde qui vous transperce et vous suit. On est dans le travestissement et la métamorphose, la distorsion et la déconstruction. On est dans l’effet miroir et le simulacre, vers une nouvelle image de soi où se côtoient transgression, dissimulation et provocation. Moins ludique, sur l’autre main courante, la série de nombrils en deux panneaux intitulée Nouvel ordre mondial (2018-2020) où trente-huit personnes se sont prêtées au jeu de la photographie. Certains nombrils, tels des boutons posés sur toutes morphologies, ont une signature, un commentaire, un mot, une phrase en guise de tatouage, une pratique millénaire, qui n’a plus rien de subversif.
Lui faisant face, la série Futur antérieur (2017) est une série de photomontages ayant pour source les films égyptiens des années soixante, série qui avait été présentée à l’Institut du Monde Arabe à Paris, lors de l’exposition Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida. Dans un pays de cinéma et de comédies musicales, Nabil Boutros réinterprète ces séquences en les légendant au regard d’événements d’aujourd’hui et en écho à ses souvenirs personnels. Il digresse et raconte des histoires dans l’histoire, des rêves du passé, des traces de l’enfance, dans des temps qui se télescopent.
Dans un grand espace de ce même premier étage, de l’autre côté, la dernière pièce du puzzle pour reconstituer le portrait de l’artiste, Condition Ovine (2014), impressionne. Soixante et onze photos de 60 x 60 cm, et autant de brebis, d’agneaux et de béliers, portraits en gros plans photographiés de façon très élaborée et qui sont alignés les uns à côté des autres, tels des stars. Ils sont tous différents, certains à la laine épaisse, d’autres parfaitement lisses, des jeunes et des vieux aux robes de toutes nuances, quelques-uns portent une cloche, d’autres une marque de métal telle une boucle d’oreille. Pour ce court instant de vie fixé en chambre noire, Nabil Boutros a recherché des éleveurs qui acceptent d’aménager leur bergerie en studio photo. Ils sont ici en majesté, chacun est unique et arbore avec fierté et individualité ses signes distinctifs. L’agneau demeure le symbole sacrificiel par excellence, dans les trois religions monothéiste – judaïsme, christianisme, islam. Entre sédentarité et transhumance saisonnière, les moutons ont leurs codes et règles de conduite dont l’instinct grégaire qui leur commande de se regrouper quand ils se sentent menacés. La salle est impressionnante et mérite qu’on s’y attarde.
L’oeuvre de Nabil Boutros joue de la distance ironique et caustique, de l’humour, de la dérision, de l’absurde pour inventer un réel qu’on dirait plein de torrents et de troubles. Son pouvoir de la narration – mis en exergue par la commissaire d’exposition, Katerina Gregos, dans la rétrospective des œuvres présentées dans ce magnifique Centro Atlántico de Arte Moderno/CAAM de Las Palmas – est sensible et magnétique. Près de chaque séquence photographique se trouvent un discret cartel et quelques mots de l’artiste. Les tirages sont superbes, impression en Papel Rag photographique sur carton plume, ce papier-coton très lisse au blanc naturel pour des couleurs intenses et des noirs particulièrement profonds.
Nabil Boutros a réalisé de nombreux autres travaux et publié divers ouvrages. « Les images, contrairement aux mots, sont accessibles à tous, dans toutes les langues, sans compétence ni apprentissage, préalables » écrit justement Régis Debray, écrivain et philosophe. Et derrière les mots, rien n’est transmissible que la pensée. « L’idée qui passe ne fait pas d’ombre elle est l’oiseau d’un ciel d’encre il coule dans nos yeux il écrit le monde » dit le poète Bernard Noël dans La Chute des temps, avant de poursuivre : « L’image, qu’est-ce que l’image quand la vie vient sur nous et plus rien que son pas de passante pressée ce que je dis est une larme… »
L’œuvre de Nabil Boutros, multiforme, communique émotion et perception du monde. Elle est habitée et pose la question de la représentation, du sacré, des forces à ne puiser qu’en soi-même, de l’éthique et de la transmission. Une urgence culturelle.
Brigitte Rémer, le 21 octobre 2023
Séries des œuvres exposées : Serie Coptes du Nil, 1997-2004. Impresión en Papel Rag Photographique 210 g sobre cartón pluma. 15 de 75x 21cm – Serie Egypt is a moderns country, 2006. Impresión en Papel Rag Photographique 210 g sobre cartón pluma. 17 de 75x103cm, 8 de 75x 60 cm – Serie Alexandria, 2004. Impresión en Papel Rag Photographique 210 g sobre cartón pluma 10mm. 20 de 75 x 52 cm – Serie Cairo, 2004. Impresión en Papel Rag Photographique 210 g sobre cartón pluma.25 de 75x119cm – Serie Egyptians, 2011. Impresión en Papel Rag Photographique 210 g sobre cartón pluma.24 de 60x50cm – Serie Spring trip, 2012. Wallpaper encolado directo a pared. 6 de 100x145cm – Serie Ovine Condition, 2014. Impresión en Papel Rag Photographique 210 g sobre cartón pluma. 75 de 60x60cm – Serie Future antérieur, 2017. Impresión en Papel Rag Photographique 210 g sobre cartón pluma. 7 de 82x110cm – New World Order. Serie Belly Buttons, 2020. Impresión en papel Rag Photographique 210 g sobre cartón pluma. 120 de 30×30 cm – An attempt to build pyramids today, 2023. Instalación, wallpaper encolado a cartón. Cuatro de 261×189, 4 de 210×150, 20 de 159 x 105, 16 de 132 x 93 cm – * Voir nos différents articles dans www.ubiquité-cultures.fr rubrique Archives.
Rétrospective Ojalá estuviera en Egipto – 20 juillet 2023 au 21 janvier 2024, du mardi au samedi de 10h à 21h, le dimanche de 10h à 14h – au Centro Atlántico de Arte Moderno/CAAM, Calle de Los Balcones, Las Palmas de Gran Canaria – tél. +34 928 311 800 – site : www.caam.net.