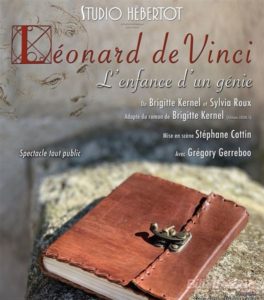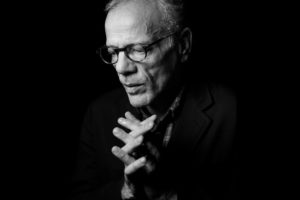D’après Sur les valises, comédie en huit enterrements, de Hanokh Levin – mise en scène Krzysztof Warlikowski – traduction en polonais Jacek Poniedzialek – adaptation Krzysztof Warlikowski et Piotr Gruszczynski – à Chaillot/Théâtre national de la Danse – spectacle en polonais surtitré en français et en anglais.
Dans le quartier populaire d’une ville non identifiée, les habitants désenchantés rêvent d’un ailleurs, forcément meilleur, mais se piègent eux-mêmes dans leur incapacité à agir et leur immobilité. Pour vivre, ils se construisent quelques mirages, leur destin ne s’accomplit jamais, ils n’ont aucune perspective d’avenir. La mort devient alors leur seul mode d’expression, ou leur dernière utopie. Huit enterrements rythment les trois heures trente de spectacle duquel humour et sexualité ne sont pas absents, dans un jeu grinçant entre Eros et Thanatos.
Une vingtaine d’acteurs du Nowy Teatr de Varsovie, fondé par Krzysztof Warlikowski en 2008, s’emparent des personnages de cette pièce radicale et cynique comme l’est l’ensemble de l’écriture théâtrale de Hanokh Levin (1943-1999). Né en Palestine sous mandat britannique, de mère polonaise, l’auteur a publié différentes formes littéraires comme des poèmes, récits, chansons, etc. mais s’intéresse particulièrement au théâtre. Il est aussi metteur en scène, a écrit une cinquantaine de pièces et en a monté un certain nombre. « Mon avis est que le théâtre est plus séduisant. Plus interpellant parce que vous voyez les choses se passer devant vous… » disait-il. Métaphore de la société, l’ensemble de son écriture dramatique est centré sur la famille et la vie d’un quartier, et met en scène les aspirations de personnages étriqués et coincés dans leur vie. Hanokh Levin excelle dans la satire politique et les propos subversifs. On le connaît en France par sa pièce Kroum l’ectoplasme, mise en scène à Avignon en 2005 par Krzysztof Warlikowski, et en 2018 au TGP de Saint-Denis par Jean Bellorini, avec la troupe du Théâtre Alexandrinski de Saint-Pétersbourg, pièce qui décrit un univers de ratage et de conformisme.
On s’en va s’ouvre sur un grand espace central dont le plancher ressemble à celui d’une salle de bal, avec en fond de scène des portes vitrées de ce qui se révélera être un funérarium. Une rangée de chaises y sont alignées. Au-dessus, un écran pour projection de vidéos. Côté cour quelques chaises de skaï rouge et tables bistrot alignées devant des portes et fenêtres donnant sur une salle de bains/WC carrelée de blanc et fermée d’un grillage, dont on ne devine qu’une partie. L’espace se transforme en toilettes publiques signalées par lettres lumineuses, Lady d’un côté, Gentleman de l’autre. À jardin, le drapeau d’Israël, bicolore blanc et bleu, portant l’étoile de David, s’agite sur fond de coupes sportives, canapé et fauteuil pour intérieur banal. La scénographie dessine les différents espaces que sont les lieux de vie des personnages, assez insignifiants, (scénographie de Malgorzata Szczesniak). La retransmission à la radio de Diva, chanson de l’artiste israélienne trans, Dana, gagnante de l’Eurovision 1998, débute le spectacle et dans la playlist du metteur en scène, on entendra Madonna et Michelle Gurevitch.
Mais que racontent ces personnages qui se croisent, se décroisent et se convoitent ? Ils parlent de leurs tribulations et de leurs désirs, de leurs attentes, échangent de petites conversations en tout genre et s’enterrent les uns après les autres. Les femmes sont pimpantes, extraverties et « faciles » et les hommes de ridicules chasseurs, tout le monde est border line, chacun sur sa trajectoire. Une touriste américaine soudain tombe du ciel et occupe l’espace médiatique du quartier, très préoccupée à se « selfier ». Un mirage de plus pour ceux du quartier dont le nombre fond à vue d’œil puisqu’on les célèbre, un à un, dans leur passage de vie à trépas.
Du stylo au plateau l’humour noir devient caricature, le mauvais goût calculé, vulgarité. Cette galerie de portraits grinçante et acide offre des récits discontinus et serait une métaphore de la société israélienne d’où est issu Hanokh Levin et/ou métaphore de la Pologne, pays de Warlikowski où l’antisémitisme n’est jamais loin et où les orientations politiques d’aujourd’hui conduisent à la restriction des libertés. « L’œuvre théâtrale de Hanokh Levin est imprégnée d’une critique virulente de la réalité politique, sociale et culturelle de l’État d’Israël. Avec une acuité hors du commun, Levin n’a cessé d’interpeller ses concitoyens contre les conséquences nuisibles d’une occupation durable des territoires conquis » analyse Nurit Yaari, professeur à l’Université de Tel-Aviv.
Krzysztof Warlikowski emboite le pas à Hanokh Levin et nous entraîne, par les arcanes du tragi-comique, dans un monde décadent qui semble le fasciner et nous tétanise. Règlements de comptes, transposition, déconstruction et effets scéniques nous plongent dans le néant. Les acteurs mènent avec talent leur partition jusqu’au-boutiste entre sensualité, érotisme et férocité, composantes de ce qui devient le système Warlikowski à base de transgression, de provocation et de crépusculaire. Élève de Krystian Lupa et formé à l’École nationale supérieure du théâtre de Cracovie il enchaîne les mises en scène de théâtre depuis plus de vingt-cinq ans, de Shakespeare à Sarah Kane, de Racine à Gombrowicz, et depuis une dizaine d’années met en scène l’opéra, de Verdi à Glück et de Berg à Wagner. Remémoration et désintégration sont devenus ses maîtres-mots, dans un monde fragmenté et féroce où l’humour noir se teinte de ressentiment. Les ambiguïtés historiques polonaises non réglées se superposent à la cruauté des textes de Hanokh Levin et, dans le langage artistique de Krzysztof Warlikowski explosent, entre discordance et perturbation. Dans sa radicalité, tout espoir s’est absenté. Ne reste que la dérision, bien empaquetée dans une enveloppe théâtrale lointaine et froide.
Brigitte Rémer, le 23 novembre 2019
Avec : Agata Buzek, Andrzej Chyra, Magdalena Cielecka, Ewa Dalkowska, Bartosz Gelner, Maciej Gasiu Gosniowski, Malgorzata Hajewska-Krzysztofik, Jadwiga Jankowska-Cieslak, Wojciech Kalarus, Marek Kalita, Dorota Kolak, Zygmunt Malanowicz, Monika Niemczyk/ Dorota Pomykala, Maja Ostaszewska, Jasmina Polak, Piotr Polak, Jacek Poniedzialek, Magdalena Poplawska, Maciej Stuhr. Scénographie et costumes Malgorzata Szczesniak – musique Pawel Mykietyn – lumières Felice Ross – mouvement Claude Bardouil – animations et vidéo Kamil Polak – assistance à la mise en scène Katarzyna Luszczyk, Adam Kasjaniuk – dramaturgie Piotr Gruszczynski, assisté de Adam Radecki – maquillages et perruques Monika Kaleta – régie plateau Lukasz Luszczyk – direction technique Pawel Kamionka – traduction française Margot Carlier – traduction anglaise Arthur Zapalowski – surtitrage Zofia Szymanowska.
Du 13 au 16 novembre 2019, 19h30 – Chaillot/Théâtre national de la Danse, 1 place du Trocadéro 75116 Paris – tél. : 01 53 65 30 00 – site : www.theatre-chaillot.fr