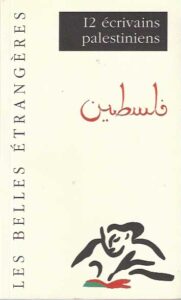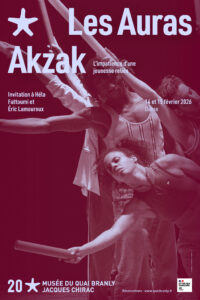Texte Nicolaï Erdman, traduction André Markowicz – mise en scène Jean Bellorini, avec la troupe du Théâtre National Populaire de Villeurbanne – au Théâtre Nanterre-Amandiers.
Jean Bellorini et le Théâtre National Populaire avaient créé la pièce en décembre 2022 à Villeurbanne et l’avait présentée en février 2023 à la MC93 Bobigny. Ubiquité Culture(s) en avait rendu compte et propose ci-dessous lecture de son article, réactualisé. Aujourd’hui, derrière la farce absurde, l’œuvre résonne avec les dérives totalitaires de notre époque. Le spectacle est actuellement en tournée.
Après le grand succès remporté par sa première pièce, Le Mandat, mise en scène à Moscou par Vsevolod Meyerhold en 1925 et jouée dans toute l’Union soviétique – elle ne sera toutefois éditée qu’en 1987 au moment de la perestroïka – Nicolaï Erdman (1900-1970) est arrêté et exilé, contraint à la relégation à partir de 1933, pour avoir écrit un poème caustique envers Staline. Autorisé à revenir à Moscou en 1949, il côtoie l’écrivain Boulgakov, le compositeur Chostakovitch, l’acteur et metteur en scène Iouri Lioubimov, fondateur du Théâtre de la Taganka, et bien d’autres. II écrit de nombreux scénarios y compris pour des films primés à l’étranger mais sa seconde pièce, Le Suicidé, ne sera jamais jouée en URSS de son vivant. Après plusieurs tentatives, Lioubimov ne réussira à la monter qu’en 1990, après différentes tentatives, dont une en 1965 puis en 1982.
En se plongeant dans la première pièce de Nicolaï Erdman qu’il met en scène, Meyerhold avait repéré le talent particulier de l’auteur et écrivait : « Je considère que la ligne fondamentale de la dramaturgie russe Gogol-Soukovo-Kobyline trouve son prolongement brillant dans la pièce de Nicolaï Erdman, Le Mandat, qui ouvre une voie solide et sûre pour la création de la comédie soviétique.[1]» Si Le Mandat traite de l’imposture au pouvoir, Le Suicidé traite, de façon excentrique, de faux-semblants et de l’imposture au suicide, c’est une satire au vitriol du stalinisme et de la société soviétique, écrite en 1928. Le texte sera jugé dangereux.
Nous sommes à la fin des années 1920, dans un immeuble communautaire où Sémione Sémionovitch Podsékalnikov, homme ordinaire et chômeur, est pris d’une grande fringale qu’il essaie d’étancher en se souvenant des restes d’un saucisson de foie entamé à midi. Il réveille Maria Loukianovna, sa femme, qui, épuisée, a du mal à émerger et qui finit par lui apporter les restes du saucisson avec du pain, mais Sémione Sémionovitch décline sa proposition de tartinage et la situation dégénère : « Alors, quoi, je dois crever, d’après toi ? Crever ? C’est ça ? Oui, Maria dis-le moi franchement : qu’est-ce que tu veux avoir ? C’est mon dernier soupir que tu veux avoir ? Eh bien, tu vas l’avoir, sûr. » Entendant du bruit, apparaît la mère de Maria pour demander des comptes, jusqu’au constat que font les deux femmes de la disparition soudaine de Sémione Sémionovitch. Maria Loukianovna est aux abois, imaginant le pire, et en référence à leur conversation, qu’il pourrait se suicider. Elle se tourne vers l’icône et remet son destin dans les mains des mères de Dieu. Puis l’information fait boule de neige et les gens se regroupent, Alexandre Pétrovitch et Margarita Ivanovna d’abord, chacun y allant de son couplet, avant que ne soit ramené sur le devant de la scène le disparu, comme un animal traqué. S’ensuit une série de quiproquos dans une galerie de portraits où s’entremêlent divers personnages, chacun cherchant à tirer profit du geste supposé du futur suicidé. Certaines scènes sont savoureuses comme celle où Sémione Sémionovitch appelle le Kremlin en direct : « Tout se tait quand un colosse parle à un autre colosse. Donnez-moi le Kremlin. N’ayez pas peur, mademoiselle, donnez-moi le Kremlin. Qui est à l’appareil ? Le Kremlin ? Ici Podsékalnikov, Pod-sé-kal-ni-kov. Un individu, un in-di-vi-du. Appelez-moi quelqu’un, je sais pas, le plus haut placé. Vous avez pas ça chez vous ? Bon, alors transmettez-lui de ma part que j’ai lu Marx, et que, Marx, il m’a pas plus. Chut ! Ne coupez pas… » Sémione Sémionovitch se délecte dans le quiproquo et cultive sa peur jusqu’à entrevoir sa gloire posthume.
La farce est féroce et grinçante, comique et grotesque – on est proche de l’esprit de Nicolas Gogol – et le vaudeville ouvre sur une véritable critique sociale. Jean Bellorini avait monté la pièce avec le Berliner Ensemble en 2016 et la remet en scène avec la troupe du Théâtre National Populaire, dans un esprit cabaret. Une quinzaine de comédiens défilent, interprétant des personnages archétypes entre autres un diacre, un écrivain raté, une vieille femme, un boucher, deux serveurs, un chœur tsigane, une couturière. Les musiciens (cuivre, accordéon et percussions) donnent du rythme. Humour et insolence s’affichent au générique des personnages qu’on retient dans les scènes les plus spectaculaires comme celle, musicale, du banquet ou celle du cercueil précédant la réapparition de Sémione Sémionovitch, toujours aussi affamé. La caricature pourtant n’est jamais loin et on peut dire que les idéaux brisés de la Révolution de 1917 – évoqués notamment dans les films d’Eisenstein – ne sont pas loin de la Russie et du totalitarisme de Poutine. Et Sémione Sémionovitch s’exprimant devant sa tombe, garde la tête froide : « Camarades, je veux manger. Mais, plus encore, je veux vivre… N’importe comment, mais vivre. Quand on coupe la tête à un poulet, il continue de courir dans la cour la tête coupée, même comme un poulet, même la tête coupée, mais vivre. Camarades, je ne veux pas mourir : ni pour vous, ni pour eux, ni pour une classe, ni pour l’humanité, ni pour Maria Loukianovna. »« À l’issue du Suicidé, le spectateur doit parler aux étoiles, qui ne le regardent même pas » écrit André Markowicz, qui signe la traduction.
Jean-Pierre Vincent avait monté la pièce en 1984 avec les acteurs de la Comédie Française. Jean Bellorini aujourd’hui, en tant que directeur du Théâtre National Populaire de Villeurbanne est un autre défenseur de l’esprit de troupe, il est aussi un excellent directeur d’acteurs et tous ici excellent dans leurs partitions. Le théâtre russe l’intéresse. Avant Villeurbanne il avait dirigé le Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis et présenté entre autres, en 2017, un très beau Karamazov et en 2019 une tout aussi puissant Onéguine d’après Pouchkine (cf. nos articles des 15 janvier 2017 et 23 avril 2019). Ardent partisan d’un théâtre populaire et poétique, il s’intéresse à toutes les littératures qu’il transpose sur scène dans la générosité d’un esprit de troupe qu’il pose comme une revendication : « Continuer à faire des spectacles, contre vents et marées, avec beaucoup de monde et la sensation d’une grande famille réunie sur scène. » Et il ajoute : « Je crois au langage comme arme. »
Brigitte Rémer, le 22 février 2026
Avec : François Deblock, Mathieu Delmonté, Clément Durand, Anke Engelsmann, Gérôme Ferchaud, Jacques Hadjaje, Damoh Ikheteah, Clara Mayer, Liza Alegria Ndikita, Marc Plas, Antoine Raffalli, Matthieu Tune, Damien Zanoly, avec la participation de Tatiana Frolova. Musiciens : Anthony Caillet (cuivres), Marion Chiron (accordéon), Benoît Prisset (percussions). Collaboration artistique Mélodie-Amy Wallet – scénographie Véronique Chazal et Jean Bellorini – lumière Jean Bellorini assisté de Mathilde Foltier-Gueydan – son Sébastien Trouvé – costumes Macha Makeïeff assistée de Laura Garnier – coiffure et maquillage Cécile Kretschmar – vidéo Marie Anglade – décor et costumes Ateliers du TNP. Le spectacle a été créé le 15 décembre 2022 au Théâtre National Populaire, Villeurbanne – [1] Rapporté dans la préface de Béatrice Picon-Vallin pour la publication de Le Suicidé, éditions Les Solitaires intempestifs, Paris, 2006.
Du 13 au 21 février 2026, mardi à vendredi à 20h, samedi à 18h30, dimanche à 16h, au Théâtre Nanterre-Amandiers, 7 Avenue Pablo Picasso, Nanterre – Ligne/ arrêt Nanterre-Préfecture – à pied par le parc ou la ville (10mn) : Sortie 1 Carillon – En bus : Sortie 3 boulevard de Pesaro (Bus 160 ou 259) – Bus 259 au 61 avenue Salvador Allende – tél. : 01 46 14 70 00 – site : nanterre-amandiers.com – En tournée, les 5 et 6 mars 2026, à Château Rouge, scène conventionnée d’intérêt national art et création, à Annemasse (74).