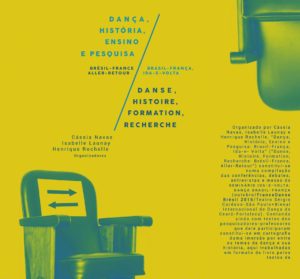Texte Jean Pierre Siméon – Mise en scène Charles Meillat – Création musicale et interprétation Joaquim Pavy – Avec Maya Outmizguine – Collectif Champ Libre.
La mère se tenait debout… Stabat Mater… « Dans le chagrin qui la poignait, cette tendre Mère pleurait son Fils mourant sous ses yeux… » écrit le franciscain italien Jacopone da Todi au XIIIème siècle. Mis en musique par de nombreux compositeurs comme Boccherini, Dvořák, Rossini, Schubert, Szymanowski, Vivaldi et d’autres, c’est le Stabat Mater de Pergolèse composé en 1736 qui met le projecteur sur la Mater Dolorosa apparentée à la Pietà des peintres italiens du XIVème siècle.
Dans le poème dramatique de Jean-Pierre Siméon, la mère qui se tient debout ne s’inscrit ni dans le sacré ni dans la douleur. Avant le chagrin de la barbarie elle exprime sa colère et donne à entendre le cri d’une femme qui se révolte contre la guerre et la violence. Furiosa, dit l’auteur. Elle est l’archétype de la femme qui se tient debout, la puissance des mots pour arme.
Le musicien, Joaquim Pavy, occupe le plateau avec ses instruments : des guitares, banjo, daf iranien et cajón, cette caisse péruvienne destinée à la cueillette des fruits. Il chante magnifiquement, d’une voix tantôt grave tantôt proche du contre-ténor, gère la sono et convoque les chœurs. Sa composition s’inspire des arabesques du Stabat Mater de Vivaldi. L’actrice, Maya Outmizguine, habite l’espace dans un va-et-vient entre la musique et la ville – le public qu’elle apostrophe et prend à témoin, qu’elle appelle à la mémoire et à la responsabilité. Elle est nomade, vient du fond de la salle et y repart. La force de ses imprécations fait vibrer la salle. « Ma prière, voilà, commence ma prière : J’aime que le matin blanc pèse à la vitre et l’on tue ici. J’aime qu’un enfant courant dans l’herbe haute vienne à cogner sa joue à mes paumes et l’on tue ici. J’aime qu’un homme se plaise à mes seins et que sa poitrine soit un bateau qui porte dans la nuit et l’on tue ici… Je crache sur l’esprit de guerre qui pense et prévoit la douleur. Je crache sur celui qui pétrit la pâte de la guerre et embrasse son sommeil quand on cuit la mort au four de la guerre… Je crache sur la haine et la nécessité de cracher sur la haine. Homme de guerre je te regarde. Regarde-moi. »
Elle fait le récit de l’enfance « J’ai grandi près des trois oliviers » et plus tard de l’enfance perdue, « J’étais fille, et jeune, quand j’ai vu flamber les trois oliviers » énumère les conflits et les guerres, de la Shoah à la Yougoslavie. Elle s’insurge contre la répétition des violences, des charniers, de la cruauté. « Je demande… Qu’est-ce que le flux nerveux qui court des neurones à l’extrémité du bras et fait plier l’index sur la gâchette d’une arme automatique ? Et qu’est ce qui est automatique l’arme ou le geste ? » Elle évoque la nécessité de la transmission entre les générations et de la mémoire, jusqu’à la Prière finale de l’adieu. « Il me reste ma voix » dit l’actrice qui donne tout, à voix nue ou mots amplifiés au micro, jusqu’à être à bout de souffle. Avec sa grande force de conviction et un travail en tension, Maya Outmizguine invective les consciences et appelle à la vie.
Fondé en 2015 par Charles Meillat, metteur en scène du spectacle, le collectif Champ Libre auquel appartiennent Maya Outmizguine et Joaquim Pavy rassemble une équipe de création qui interroge les arts vivants et la médiation citoyenne. Espace de recherche il réunit des artistes européens qui défendent des valeurs communes. Le Festival Champ Libre, au cœur de la saison estivale, à Saint-Junien (Haute Vienne) est un temps fort de l’activité. Dans Stabat Mater Furiosa la musique soutient le verbe et le verbe nourrit la musique. L’écoute et le dialogue qui se construisent entre le musicien et l’actrice fonctionne remarquablement et éclaire les intentions de mise en scène. Le premier, ethnomusicologue, est multi-instrumentiste et s’intéresse aux musiques d’autres cultures, notamment aux cérémonies et rituels populaires. La seconde, cherche autour du théâtre et de la gestuelle au sein d’un collectif, le Théâtre du Balèti. Le texte de Jean-Pierre Siméon fédère leurs univers et leurs recherches. L’auteur connaît le théâtre. Critique littéraire et dramatique, il fut dramaturge auprès de Christian Schiaretti au CDN de Reims puis au TNP de Villeurbanne. Schiaretti a monté le Stabat Mater Furiosa pour la première fois, en 2009, avant de mettre en scène l’adaptation de son Philoctète d’après Sophocle dont le rôle-titre était tenu par Laurent Terzieff, peu avant sa disparition. Ici son texte est adressé et utilise la première personne, le je, décuplant la révolte. « Je sais mes questions. C’est comme demander quelle est l’intention du gel qui tue le fruit, du vent qui tue la branche, du nœud de sable qui tue la source, je sais mes questions n’ont pas de réponses et c’est pourquoi je les pose, pour qu’enfin se taise le discours des effets et des causes. » Et Prévert ajouterait : Quelle connerie la guerre !
Brigitte Rémer, le 2 mai 2018
Avec Maya Outmizguine (jeu) et Joaquim Pavy (musique live et création) – assistant à la mise en scène Camille Voyenne – création lumière Marin Peylet – Production Collectif Champ Libre – Le texte de Jean Pierre Siméon, Prix Goncourt Poésie 2016, est publié au Solitaires Intempestifs.
Du 6 au 24 avril à la Comédie-Nation, 77 rue de Montreuil. 75011 – métro Nation ou Boulets – site : www. comedienation.fr – Tél. : 01 48 05 52 44. Contacts Champ Libre : 60 Route de la Forge, Le Monteil 87200 Saint-Junien – Site : www.festivalchamplibre.com