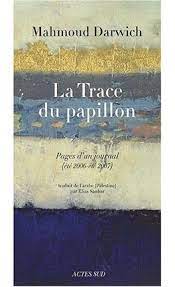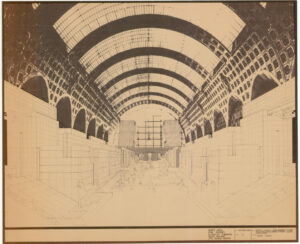D’après Répons des ténèbres de Carlo Gesualdo, par Les Arts Florissants, sous la direction de Paul Agnew – chorégraphie Amala Dianor, interprétée par les danseurs de la compagnie – à La Philharmonie de Paris/Cité de la Musique.
Six chanteurs des Arts Florissants et quatre danseurs de la Compagnie Amala Dianor accompagnent la Passion du Christ à travers l’œuvre de Carlo Gesualdo (1566-1613). Car ceci est mon corps disent les textes… Paul Agnew et Amala Dianor ont conçu le spectacle en commun, mettant en mouvement les chanteurs et en musique les danseurs.
Fils cadet d’un prince esthète et mélomane, Carlo Gesualdo a deux prédispositions, la chasse et la musique. Deux musiciens de talent à la cour du Prince son père, lui apprennent le contrepoint mais les circonstances l’obligent tout d’abord à régner pour remplacer son frère décédé des suites d’une chute de cheval. On le contraint de ce fait à épouser sa cousine, Maria d’Avalos, pour donner une descendance à la famille, destinée tragique à laquelle il met fin, en l’assassinant en même temps que son amant.
Carlo Gesualdo hérite des titres de son père quand il meurt. Personnage étrange et violent, vindicatif, il garde cependant une grande piété. Les meilleurs musiciens méridionaux se mettent à fréquenter sa maison. Il dédie sa vie à la musique, on lui reconnaît un style unique, nourri de nombreuses influences, dissonances et chromatismes. Les compositeurs modernes tels que Stravinski, Ligeti, Eötvös et bien d’autres s’en sont inspirés. Il compose cent-vingt-cinq madrigaux répartis en six livres publiés entre 1594 et 1611, et soixante-neuf motets.
Le recueil des Répons des Ténèbres en comprend vingt-sept, plus un Miserere à six voix, destinés aux matines de la Semaine Sainte, ils s’étirent sur le thème de la pénitence, tout y est codifié. Le Répons est une sorte d’enluminure polyphonique précédant des lectures psalmodiées, il vient de la Renaissance et se crée dans l’obscurité progressive au fil des événements s’acheminant vers les dernières heures du Christ, jusqu’à l’extinction de toute lumière. C’est un office des Ténèbres. « Mon âme est triste jusqu’à la mort, Demeurez ici et veillez avec moi. » Les versets des Répons paraphrasent la Passion et l’agonie du Christ pour inviter à une véritable méditation sur la mort, la culpabilité, le repentir et la rédemption. Ils collent au parcours de Gesualdo, compositeur plein de démons, habité de remords et hanté par sa propre fin.
Les Arts Florissants connaissent bien l’univers du compositeur, ils ont enregistré l’intégralité de ses madrigaux. Fondés en 1979 par William Christie, Paul Agnew, ténor et chef d’orchestre britannique les a rejoints depuis une vingtaine d’années. La nouveauté avec Gesualdo Passione est ce croisement avec la danse et la compagnie Amala Dianor. Les chanteurs se déplacent sur la scène, font cercle, puis groupe, et à certains moments, se mêlent aux danseurs. Les lumières (Xavier Lazarini) soulignent un climat de recueillement et de majesté et les contre-jours renvoyés sur un grand écran placé en fond de scène détachent les silhouettes des pénitents.
Pour le chorégraphe Amala Dianor d’abord formé au rap et qui hybride les langages, comme pour les danseurs de la compagnie – venant de Rome, du Burkina Faso et du Sénégal – formés à différents styles de danse, la musique de la Renaissance est une première. Ils entrent de plain-pied dans ce chant polyphonique qui les porte jusqu’à la crucifixion et les mène des ténèbres à la lumière divine. Ils sont Jésus et Marie-Madeleine, Judas et la Madone, Barrabas et Simon de Cyrène, ils sont le Mont des Oliviers, la croix, la Passion et la mise au tombeau, la rédemption et la résurrection, comme sur l’art pictural de la Renaissance italienne à travers Piero della Francesca et Tintoretto, Raphaël et Michel-Ange, de Vinci et Le Caravage. On est dans ce clair-obscur de la peinture qui dynamise la scène/Cène et développe le thème de la pietà, Marie soutenant le corps sans vie de son fils. Le chant et la danse apportent harmonie, symétrie et équilibre à l’ensemble de la représentation.
La synergie entre les chanteurs et les danseurs fait penser à ce qu’étaient au Moyen-Âge les Mystères, la Passion du Christ pour sujet central. Ici le texte est chanté et psalmodié en une polyphonie savante et la succession de tableaux animés évoque ces Mystères. Entre l’art du chant et de la musique et l’art de la danse, on passe de la simplicité à la complexité et de l’art savant à l’art populaire. La voix est chaude et le geste l’accompagne avec sensibilité, modernité et dans une grande maîtrise. L’amplitude et l’expressivité tant dans la musique que dans la danse ouvrent sur une forme de beauté liturgique pleine de vibrations. Gesualdo Passione est une méditation sur la mort qui chante la vie.
Brigitte Rémer, le 30 juin 2025
Avec : Les Arts Florissants – Paul Agnew , direction, ténor – Miriam Allan, soprano – Hannah Morrison, soprano – Mélodie Ruvio , contralto – Sean Clayton, ténor – Edward Grint , baryton-basse. Compagnie Amala Dianor – Amala Dianor, chorégraphe – Elena Thomas, danse – Damiano Ottavio Bigi, danse – Pierre-Claver Belleka, danse – Clément Nikiema, danse – Xavier Lazarini, création lumières. Coproduction Kaplan/Compagnie Amala Dianor, Les Arts Florissants, Le Volcan-Scène nationale du Havre, Les Nuits de Fourvière-festival international de la Métropole de Lyon, MC2-Grenoble et la Philharmonie de Paris.
Les 5 et 6 juin 2025 à la Philharmonie de Paris / Cité de la Musique, 221 avenue Jean-Jaurès. 75019. Paris – métro : Porte de Pantin – tél. : 01 44 84 44 84 – site : www.philharmoniedeparis.fr – En tournée : 22 septembre 2025 Opéra de Bordeaux – festival Cadences – 16 octobre 2025 Barbican Center, Londres, GB in the frame of Dance Umbrella Festival – 27 janvier 2026 Opéra de Limoges, France – 29, 30 janvier 2026 Opéra, Montpellier danse – 26 février 2026 Auditorium de la MC2 Grenoble – 26, 27 mars 2026 Le Volcan, Le Havre – 17, 18, 19 juin 2026 Maison de la Danse de Lyon & Les Nuits de Fourvière.