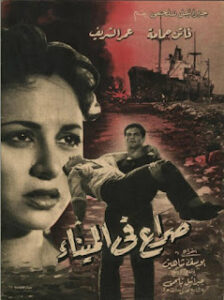De Jonas Hassen Khemiri, traduction du suédois Marianne Ségol, mise en scène Christophe Rauck – au Théâtre Nanterre-Amandiers, centre dramatique national.
On entre dans un dispositif bi-frontal au bout duquel, de part et d’autre se trouve un écran. Christophe Rauck, metteur en scène, spatialise ainsi le diptyque qu’il propose sous le titre Presque égal, presque frère, en rassemblant deux pièces de l’auteur suédois Jonas Hassen Khemiri : Presque égal à et J’appelle mes frères, qui traversent plusieurs temporalités. Le dispositif scénographique est signé Simon Restino, il permet aux acteurs de se mêler au public pour le prendre à témoin, la création lumière d’Olivier Oudiou construit des atmosphères.
Dans la première pièce, Presque égal à, s’entrelacent des parcours qui marquent de grands écarts entre ceux qui possèdent et ceux qui n’ont rien. On entre dans la galaxie de l’économie et du rendement. « Je tombe » dit le premier acteur déjà au sol et se fondant à la poussière interstellaire d’où il voit la terre, vue du ciel. La galerie des portraits proposée par Christophe Rauck nous mène, dans une certaine distance humoristique, du XVIIIème siècle avec la réussite de Casparus Van Houten le roi du chocolat, comme une apparition sur fond de clavecin, à la brutalité du monde d’aujourd’hui dessinée à grands traits : les petits boulots et les moyens de survie pour Peter le vrai-faux SDF ; la recherche d’emploi d’Andrej, fraîchement diplômé, plein de bonnes intentions et bientôt chez Pôle emploi rempli d’amertume, « à l’avenir ! » ; le brillant universitaire, Mani, polarisé sur ses connaissances et déconnecté, en attente de reconnaissance ; le rêve de Martina d’avoir une ferme bio, taraudée par son double qui lui souffle le chaud et le froid, disant tout haut ce qu’elle pense tout bas et qui écoute, hébétée, les recommandations de la coach, vraiment très coach, « que deviendriez -vous si vous suiviez votre voie (voix) ? Freya jeune licenciée, en short et chaussettes jaunes qui attend son heure ; Erica virée du tabac qui l’emploie ; le bonimenteur à la veste à paillettes et son étude de marché qui nous fait de l’œil et joue de vitesse sur patins à roulettes
Le capitalisme et sa balance commerciale bat son plein, les billions voltigent, la folie de l’or rôde, les bingos entretiennent l’espoir. Les formes et les formules d’investissement pour « un taux minimum de rendement » s’inscrivent au sol dans un mouvement d’accélération et d’hystérie du monde. On voyage avec les personnages, leurs espoirs et désespoirs, leurs aspirations et leurs leurres, leurs utopies, du dialogue à la pensée in petto, du témoignage à la conférence, de l’apostrophe à la péroraison, du texte qui s’affiche sur écran et jusqu’à la duperie généralisée.
Tout se compte et se paye : l’animateur du mariage de la sœur de Martina, dont l’époux arrive en chapeau claque et voiture tamponneuse, le coaching de la dame en violet payée par les parents, les enchères permanentes, l’héritage de la petite ferme pour l’une qui déshérite l’autre, le parfum et les cigarettes volées, celui qui peut payer la rançon celui qui ne peut pas et se fait flinguer, le flashback de la dèche mais de la bonne humeur de la vie étudiante, le travail au black, la passion des riches pour la pauvreté, la « petite bourge de merde… » qui prépare sa réplique à la jalousie du mari : « Peter (le SDF) est tellement vrai !Tu es dans la théorie il est dans la pratique… » l’accident et la théâtralité autour, le tourbillon de la vie où « rien ne s’est passé comme prévu… » mais où il ne faut pas « baisser les bras. »
Et comme « le show doit continuer », après l’entracte et deux heures de spectacle, le public est convié à la seconde pièce, J’appelle mes frères, introduite par quelques notes de clavecin qui font le lien avec la première partie, comme l’esprit de la mise en scène et dans le même dispositif scénographique. Tirée du roman au nom éponyme, Jonas Hassen Khemiri, l’a écrite en 2012, en écho à l’attentat de Stockholm en 2010 qui se voulait être une réponse aux caricatures du Prophète. Il s’est aussi exprimé après l’attaque de Charlie-Hebdo à Paris, en 2015. La pièce met en scène un homme, Amor, que ses amis appellent après l’explosion d’une voiture piégée au centre-ville, acte terroriste commis par un Irakien, et qui sème la panique. Un paysage de neige, le sol est blanc, une voiture sur le côté – cour ou jardin, selon -. Les appels par mobile sont au cœur du sujet et le lien entre les personnages. Shavi, l’ami d’enfance nouvellement père, Valéria, Ahlem, Tyra, le bordent de recommandations contradictoires, et le mobile devient un personnage principal du récit. L’angoisse, les mises en garde et les mots de tendresse et de provocation fusent. Les ami(e)s prennent place dans cette voiture pour le haranguer, une caméra renvoie des images sur l’écran.
Pour Shavi, en contemplation devant son nouveau-né, Amor, qu’il appelle Hélium parce qu’il tente de transformer les drames en légèreté – il est d’ailleurs souvent perché sur la voiture – les flash-back d’enfance et d’école reviennent. Shavi ne cesse de l’appeler pour des recommandations comme rester chez lui et se méfier de tout, dans un contexte de suspicion généralisée, de peur de l’étranger et de préjugés basés sur une montagne de stéréotypes. « Les bâtards de racistes sont entrés au Parlement… On vit dans un pays de racistes… » Et Amor de lui demander : « T’as voté quoi ? » Autre ami(e), Ahlem, le met en garde et le ton monte dans l’échange. « T’es toujours là ? » demande-t-il/elle. Et ils se rappellent ensemble les propos racistes essuyés comme « la montagne aux singes. » « Je me souviens, et tu étais du magnésium inflammable » lui répond Amor qui commence à douter de l’hospitalité autour de lui et qui, rangeant ses affaires, tombe sur le vieux couteau rouillé qu’il affectionne, et qu’il a la mauvaise idée de mettre dans sa poche, se rendant potentiellement suspect.
Apparaît Valéria, maîtresse du développement personnel et vendeuse de rêve, puis Carolina, qui le taraude sur le droit des animaux et se découvre comme camarade de classe aussi. Entre temps, la voiture calcinée est remorquée. Amor qui était dans la ville à la recherche d’une mèche de perceuse pour sa sœur se sent en insécurité, déstabilisé car culpabilisé dès qu’il croise des policiers. La peur s’installe « dans notre deuxième pays » comme autant de caméras de surveillance dont les images remplissent les écrans, les pensées se télescopent, la folie monte. La guerre est dans les têtes. Amor se voit tuer les policiers et leurs chiens et raconte, tendu à l’extrême, couché sur la neige. Tournant sur lui-même, ses pieds dessinent les lettres de l’alphabet arabe. L’image en noir et blanc rapportée sur écran est belle, la solitude est là. La scène finale convoque une autre vision, sa grand-mère, dans sa part de simplicité et d’humanité. Face à elle, les temps se réfractent et se mêlent : « J’ai vingt-deux ans. J’ai cinquante-cinq ans… Tout me manque… » L’esprit de sa grand-mère, image sur écran et jeu sur scène. « Je t’ai suivi toute la journée, dit-elle. Il faut que tu rentres chez toi. Tu n’es pas seul, je suis là. » Dernier appel avec Shavi qui lui dit : « Je t’ai cherché… T’as entendu les explosions ? On s’appelle demain… » Et Amor le rappelant, l’implore de venir. « Attends-moi là mon frère… » lui répond Shavi qui arrive, l’amitié en bandoulière. Dans les phares de la voiture « j’ai vu un type, et ce type, c’était moi ! Mon propre reflet dans la vitre. »
Comme un entomologiste, l’auteur dessine de courtes scènes, dans la première pièce comme dans la seconde, les acteurs interprètent plusieurs personnages et changent d’identité. Figure majeure de la scène contemporaine européenne, né en 1978 de père tunisien, et de mère suédoise, Jonas Hassen Khemiri a plongé dans l’écriture par les romans dont le premier, Un œil rouge, publié en 2003, remporta un vif succès et fut adapté au théâtre, puis au cinéma. En 2006 il publie un second roman, Montecore, un tigre unique, qui traite de l’immigration et de la montée du racisme en Suède s’appuyant sur son expérience, et parle de la difficulté du métissage Il écrit cinq autres romans, tous traduits dans de nombreuses langues dont un dernier, Les Sœurs, publié par Actes-Sud en septembre 2025.
À partir de 2006 Jonas Hassen Khemiri se lance dans l’écriture dramatique, avec une commande du Théâtre municipal de Stockholm. Montée par la metteuse en scène Farnaz Arbabi, unanimement saluée par la critique, sa première pièce, Invasion ! s’y joue à guichets fermés pendant deux ans, de 2006 à 2008, avant d’être montée à Oslo, puis à la Schaubühne de Berlin, en 2016. En France elle est publiée aux éditions Théâtrales en 2007 et créée en 2010, dans une mise en scène de Michel Didym au Théâtre Nanterre-Amandiers. Depuis, Jonas Hassen Khemiri a écrit cinq autres pièces.
Christophe Rauck à la tête du Théâtre Nanterre-Amandiers depuis janvier 2021 après avoir dirigé différentes structures, s’empare de ces textes qui font exploser les stéréotypes. Au fil de son parcours il a mis en scène entre autres des textes de Brecht, Lagarce, Sara Stridsberg, Marivaux, Von Horvath, Shakespeare, Ostrovski. Avec Presque égal, presque frère il montre la violence de nos sociétés en une sorte de satire politique, mêlant le présent, le passé et le futur. Il s’empare de l’écriture de Jonas Hassen Khemiri et construit un parcours grinçant dans le langage d’aujourd’hui. La précision de son travail dans la conception générale comme dans l’art du détail et la direction d’acteurs, permet une montée dramatique puissante. Amor dans la seconde partie (Mounir Margoum) transmet une densité au personnage pleine de vérité, de reliefs et de couleurs. Christophe Rauck donne sens à la réalité des deux parties qui forment le spectacle, dans les images – dont il n’abuse pas, comme sur le plateau où le face à face des publics fonctionne grâce à la mobilité et l’attention des acteurs, et comme si nous nous interrogions réciproquement, de part et d’autre de la scène, sur le monde dans lequel on patauge.
Brigitte Rémer le 30 janvier 2026
Avec – Virginie Colemyn : Silvana, Freya, la coach emploi, Angelika (Presque égal à), Tyra (J’appelle mes frères) – Servane Ducorps : Martina, la femme de pôle emploi (Presque égal à), Ahlem (J’appelle mes frères) – David Houri : Mani (Presque égal à), Le filateur (J’appelle mes frères) – Mounir Margoum : Peter, l’homme de Pôle emploi, le pasteur (Presque égal à), Amor (J’appelle mes frères) – Julie Pilod : Martina, Laura Lorenzo (Presque égal à) Valeria et Karolina (J’appelle mes frères) – Lahcen Razzougui : Caspar Van Houten, l’orateur de l’entracte, l’employé du magasin d’alcool (Presque égal à) Shavi (J’appelle mes frères) – Bilal Slimani : Andrej (Presque égal à), le vendeur (J’appelle mes frères) – Aymen Yagoubi et Wassim Jraidi (en alternance) : Ivan, petit frère d’Andrej (Presque égal à).
Dramaturgie, collaboration artistique Marianne Ségol – scénographie Simon Restino – musique Sylvain Jacques – lumière Olivier Oudiou – costumes Coralie Sanvoisin – maquillages et coiffures Cécile Kretschmar – vidéo Arnaud Pottier – assistant à la mise en scène Achille Morin. Avec la participation artistique du Jeune théâtre national. Texte traduit avec le soutien de la Maison Antoine Vitez, centre international de traduction théâtrale. Jonas Hassen Khemiri est représenté par L’Ache/agence théâtrale (www.arche-editeur.com.) Les textes sont publiés aux éditions théâtrales.
Du 28 janvier au 21 février 2026, du mardi au vendredi à 19h30, le samedi à 18h, le dimanche à 15h, au Théâtre Nanterre Amandiers, 7 Avenue Pablo Picasso, Nanterre – Ligne/ arrêt Nanterre-Préfecture – à pied par le parc ou la ville (10min) : Sortie 1 Carillon – En bus : Sortie 3 boulevard de Pesaro (Bus 160 ou 259) – Bus 259 au 61 avenue Salvador Allende – tél. : 06.07.14.81.40 ou 06.07.14.47.83