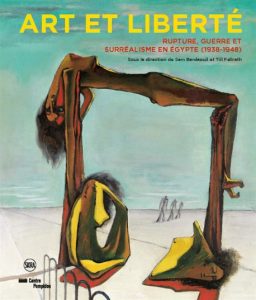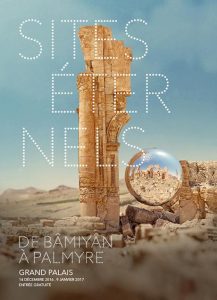Texte et mise en scène Adel Hakim – Théâtre des Quartiers du monde/Théâtre des Quartiers d’Ivry-Centre dramatique national du Val-de-Marne, à la Manufacture des Œillets – Spectacle en arabe surtitré en français, avec les acteurs du Théâtre National Palestinien.
Que le Théâtre National Palestinien soit actuellement en France relève de la gageure et de l’événement, cela donne du sens à la capacité d’un Centre Dramatique National – en l’occurrence celui du Val-de-Marne – et au positionnement d’une ville dans sa politique culturelle – Ivry-sur-Seine – de poser un geste culturel fort. La perspicacité d’Elisabeth Chailloux et d’Adel Hakim, co-directeurs du Théâtre des Quartiers d’Ivry, dans la pertinence de leur programmation et leurs démarches respectives de création, fait le reste. Le Théâtre des Quartiers du monde voulu par Adel Hakim est devenu le lieu du dialogue et de l’altérité. Après Antigone monté avec les acteurs du Théâtre National Palestinien en 2011 et qu’il vient de re-présenter dans ce nouveau lieu de la Manufacture des Œillets, il présente Des Roses et du Jasmin, texte qu’il a écrit, fait traduire en arabe et mis en scène pour la troupe de Jérusalem Est avec laquelle il développe un partenariat depuis plus de six ans. La pièce avait été créée et présentée en juin 2015 au Théâtre National Palestinien de Jérusalem et au Théâtre Al-Quassaba de Ramallah.
Des Roses et du Jasmin traverse l’histoire contemporaine du conflit israélo-palestinien, de 1944 à 1988. Trois générations d’une famille se succèdent, mettant en jeu Israéliens et Palestiniens au fil de la chronologie. Né en Egypte et ayant grandi au Liban, Adel Hakim sait de quoi il parle. Dans cette région du monde, la chronologie est percluse de guerres. La pièce est construite en trois temps, la première période, 1944-1948, débute sur un bel optimisme : Que la fête commence ! en sont les premiers mots. Miriam, née en 1925 à Berlin, rencontre à Jérusalem, alors sous occupation britannique, John, officier né à Londres en 1921. La vie est légère et gaie. De leur union naît Léa, appelée à grandir dans une ville incertaine. Mais le premier drame arrive vite, Aaron frère de Miriam né à Berlin en 1920 arrive à Jérusalem et convainc sa sœur de s’engager dans l’espionnage pour l’Irgoun. Contrainte d’accepter sous la pression, elle prête serment et se trouve bien malgré elle, complice de l’attentat de l’Hôtel King David où son mari perd la vie. En 1948, le départ des anglais et la création d’Israël sur les territoires palestiniens rendent aux Palestiniens la vie difficile, avec les premières confiscations de maisons et obligations d’exil. Saleh, ami de John, quitte Jérusalem pour le Liban avec son fils, Mohsen.
La deuxième période couvre les années 1964 à 1967. Seize ans plus tard, de retour en Palestine, Mohsen, Palestinien musulman, rencontre Léa, Israélienne juive, au grand dam de leurs parents respectifs. Les deux jeunes se marient et donnent naissance à une petite fille, Yasmine. Miriam s’enferme dans son mutisme et ne revit qu’à travers les apparitions du fantôme de John. En 1967, la Guerre des Six Jours dégrade davantage encore les relations et Israël triple son emprise territoriale. Aaron contraint sa nièce Léa à se séparer de Mohsen et la séquestre. Mohsen s’enfuit à Gaza avec leur petite fille tandis que Saleh s’engage, depuis Beyrouth, dans l’Organisation de libération de la Palestine.
La troisième période se passe en 1988 après la première Intifada appelée la guerre des pierres, dans une prison où une matonne traite de manière particulièrement brutale une prisonnière palestinienne, Yasmine. Par une série de hasards, Léa et Mohsen se retrouvent, vingt ans plus tard. Léa apprend à Mohsen qu’il était père une seconde fois d’une petite Rose, elle ne se savait pas enceinte quand la vie avait séparé le couple. La fin est amère quand se dénouent les fils de l’intrigue : Léa apprend que sa mère, engagée dans l’Irgoun, avait été complice de la mort de son père, on comprend par ailleurs que la gardienne de prison s’appelle Rose et qu’elle est bien leur fille. Privée de l’affection de sa mère, Rose se love dans ses bras avant de s’enfuir. Deux informations se succèdent et ferment le spectacle : on apprend que Yasmine est morte, violentée et assassinée en prison par des soldats. Parallèlement et après le claquement d’un coup de feu, il est dit que Rose s’est suicidée. Parcours de tragédie et fin d’un noir profond.
On est chez les Atrides, chez Antigone et dans le théâtre grec antique dans lequel Adel Hakim se reconnaît : « La tragédie grecque m’a toujours servi de modèle dramaturgique. Elle met, dans pratiquement toutes les pièces conservées, une histoire de famille, l’intime, en rapport avec la société et le monde… » On est chez Roméo et Juliette où Capulet et Montaigu s’affrontent avant de se réconcilier sur le cadavre de leurs enfants. Ici, au-delà des familles, ce sont deux peuples que rien ne réconcilie. Dans la géopolitique dont traite Des Roses et du Jasmin, texte né d’une suite d’événements historiques de cette région déchirée du monde, la fin reste tragique. Ce registre reste supportable pour le spectateur par la théâtralité élaborée à travers l’écriture et reprise sur le plateau, qui lui permet d’alléger le fardeau : en premier lieu le commentaire fait par les présentateurs des différentes périodes – Alpha et Oméga pour la première, entre Chaplin et le western ; Epsilon et Lambda pour la seconde, version pompom girls extraverties et vêtues de courtes robes rouges ; le fantôme de Saleh – tué dans le camp de Sabra et Chatila le 17 septembre 1982 – et celui de John l’officier britannique, devisant avec humour pour la troisième. La théâtralité passe aussi par l’écran placé en fond de scène qui commente l’action avec des citations-réactions permettant au spectateur un certain recul par rapport au récit ; par la musique, qui accompagne les séquences et donne subtilement tempo et pas de danse, et qui transmet le ressenti des personnages, comme le ferait une caméra subjective ; par la scénographie enfin, élément de théâtralité qui se compose de panneaux translucides entrant en action vers la fin et filtrant l’indécence, physique et morale, imposée par les hommes, évitant cruauté et crudité à vue.
D’Antigone à Des Roses et du Jasmin les acteurs sont méconnaissables, même si, au point de départ, la référence demeure. On s’en détache très vite par la densité des faits relatés et la succession d’événements historiques déversés qui tiennent le public en grande écoute et émotion, traduites par l’ovation finale. L’atmosphère est chargée et on en sort sonnés. Les acteurs sont fluides et leur élégance n’a d’égal que le drame qui se joue. Chapeau bas ! Le travail accompli par Adel Hakim tant au niveau de l’écriture que de la troupe est courageux et oblige à reposer la question de la mémoire, collective et individuelle. Et à travers Saleh qui fait figure de sage, il fait dire au final, avec justesse : « Il faudrait qu’avant d’être ennemis, avant de se faire la guerre et de s’entretuer, les êtres humains pensent qu’ils sont et ont toujours été pères et mères, fils et filles, frères et sœurs. Pas plus que des roses et du jasmin. »
Brigitte Rémer, le 29 janvier 2017
Avec Hussam Abu Eisheh (Aaron) – Alaa Abu Garbieh (Alpha, Dov) – Kamel Al Basha (Saleh) – Yasmin Hamaar (Gamma, Léa) – Faten Khoury (Epsilon, Rose) – Sami Metwasi (John) – Lama Namneh (Lambda, Yasmine) – Shaden Salim (Miriam) – Daoud Toutah (Béta, Mohsen) – direction artistique du Théâtre National Palestinien Amer Khalil –
Texte et mise en scène Adel Hakim – scénographie et lumière Yves Collet – dramaturge Mohamed Kacimi – collaboration artistique Nabil Boutros – vidéo Matthieu Mullot – costumes Dominique Rocher – chorégraphie Sahar Damouni. En collaboration avec les équipes techniques du Théâtre des Quartiers d’Ivry : Franck Lagaroje, Federica Mugnal, Léo Garnier, Dominique Lerminier, Raphaël Dupeyrot – et du Théâtre National Palestinien : Ramzi Qasim et Imad Samar – Le texte est édité à L’Avant-scène théâtre.
Du 20 janvier au 5 février 2017 – Théâtre des Quartiers d’Ivry/Manufacture des Œillets, 1 place Pierre Gosnat – 94200 Ivry-sur-Seine – Métro : Mairie d’Ivry – www.theatre-quartiers-ivry.com – Tél. : 01 43 90 11 11 – En tournée, le 25 février à la Comédie de Genève – du 28 février au 8 mars au Théâtre National de Strasbourg.