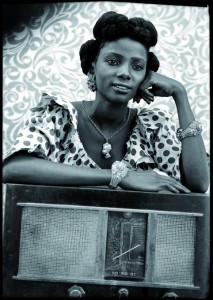Publication de l’ouvrage de Christine Douxami Le théâtre noir brésilien, un processus militant d’affirmation de l’identité afro-brésilienne, aux éditions de L’Harmattan.
Publication de l’ouvrage de Christine Douxami Le théâtre noir brésilien, un processus militant d’affirmation de l’identité afro-brésilienne, aux éditions de L’Harmattan.
C’est un ouvrage réalisé à partir de la thèse de doctorat en anthropologie sociale qu’avait soutenue l’auteure en 2001 à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, sous la direction de Maurice Godelier, qu’elle réactualise et revisite après une seconde phase d’étude sur le terrain, entre 2012 et 2014. Elle a mené des entretiens avec cent cinquante artistes de toutes formations, générations et expériences dans plusieurs espaces géographiques du Brésil que sont Rio de Janeiro, São Paulo et Salvador de Bahia, lieux les plus significatifs de l’émergence du théâtre noir brésilien.
Le Brésil reste « une société très hiérarchisée, héritière d’un passé colonial esclavagiste» constate-t-elle et l’abolition de l’esclavage signée en 1888 n’a jamais été réalité ; les discriminations sont restées puissantes, en termes quantitatifs comme qualitatifs. Le concept de démocratie sociale qui fonde la nation brésilienne repose sur trois notions, trois races : le Blanc, l’Indien et le Noir tout en reconnaissant l’égalité de tous les citoyens. Il est en fait un mythe, dénoncé lors de la Conférence de Durban en 2001, prise de conscience politique du racisme.
Partant de là le théâtre noir s’oppose-t-il au théâtre blanc ? Agite-t-il le brûlot de la ségrégation sociale, quels sont ses concepts et quelles sont ses formes ? Ce sont les questions que pose Christine Douxami qui observe les compagnies de théâtre noir devenues « de véritables laboratoires identitaires puisqu’elles créent des spectacles ayant comme objectif l’affirmation ethnique et culturelle du Noir. » Ces compagnies affirment faire un théâtre ethnique politique, La figure de Bertold Brecht fut une de ses emblèmes.
L’ouvrage aborde le théâtre ethnique de façon transdisciplinaire, interroge la dramaturgie et le marché du travail sur l’absence des Noirs, dans un premier chapitre. Il relate dans un second chapitre les premières tentatives de structuration d’un théâtre noir à partir de 1944, avec la création du Teatro Experimental do Negro à Rio de Janeiro par Abdias Nascimiento, militant noir qui devient chef de file d’un mouvement radical, intègre le concept de négritude, favorise la création d’une dramaturgie noire et entraine la création de nombreuses compagnies de théâtre noir. Solano Trindade, militant communiste, lui emboîte le pas de manière dissidente et devient le second porte-flambeau de ce théâtre, développant une autre idéologie et de nouvelles esthétiques. Le troisième chapitre parle des héritiers du Théâtre expérimental du Noir, à Rio de Janeiro, São Paulo et Salvador de Bahia et analyse certaines expériences actuelles.
La question de la frontière entre l’engagement et l’exigence artistique est posée dans le premier chapitre, ou comment allier discours politique et propos esthétique, question récurrente s’il en est, qu’il s’agisse du théâtre noir ou d’autres formes de théâtre engagé. Dans le cas du théâtre noir brésilien, les préjugés à l’égard des acteurs sont réels et l’invisibilité de l’acteur noir fait partie du contexte politique global, la presse et la publicité en témoignent. Il est longtemps resté otage d’une image stéréotypée offrant soit des rôles subalternes, soit des rôles du théâtre alternatif restant confidentiels, soit des rôles comiques comme au début du XXème. C’est à partir de 1944 avec la création du Teatro Experimental do Negro d’Abdias Nascimiento, auteur et metteur en scène, que l’acteur noir commence à paraître sur scène, très progressivement, s’appuyant sur le répertoire nord-américain – les pièces d’Eugène O’Neill notamment – et avec l’écriture en 1946 de la pièce Anjo Negro de Nelson Rodrigues, ami de Nascimiento qui met en scène le racisme et donne le coup d’envoi d’une véritable dramaturgie. Différents thèmes sont développés dans cette sensibilité, comme les amours interraciales, la reconstruction de la mémoire collective, la contestation révolutionnaire et la valorisation des racines afro-brésiliennes à partir des traditions et des religions, et portées aussi par des actrices comme Ruth de Souza et Aguinaldo Camargo. Par ailleurs, certains réalisateurs comme Glauber Rocha et le cinéma Novo dans les années soixante, ont donné un véritable statut de héros noir à quelques acteurs, au milieu du XXème siècle.
La seconde période de développement du théâtre noir, après les années de dictature au Brésil de 1964 à 1985, débute dans les années soixante-dix au moment des indépendances des pays d’Afrique et du mouvement Black Power aux Etats-Unis. Les dissidents du Teatro Experimental do Negro prennent le relais et notamment Haroldo Costa qui, à partir du groupe qu’il crée en 1949, Grupo dos Novos appelé ensuite Brasiliana, cherche à mettre en scène les apports d’origine afro-brésilienne dans la culture populaire brésilienne et à transporter sur scène les cérémonies religieuses et les fêtes populaires. Plusieurs personnalités le rejoignent dont Solano Trindade, appelé le poète du peuple, qui créera ensuite sa propre compagnie Teatro Popular Brasileiro sur fond d’idéologie communiste. Pour Christine Douxami, deux concepts de théâtre noir se font face, deux écoles : celle qui cherche à intégrer l’art populaire, avec Solano et celle d’Abdias Nascimento, plus érudite.
La troisième partie de l’ouvrage regarde les héritiers du théâtre expérimental du Noir, à partir de trois aires géographiques. A Rio de Janeiro le Grupo Ação engagé dans les mouvements de gauche et mené par Milton Gonçalves ; l’Instituto de Pesquisa sobre as Culturas Negras mené par Léa Garcia, actrice ayant fait partie du Teatro Experimental do Negro, et le Théâtre de l’Opprimé d’Augusto Boal ; la Compagnie Black e Preto fondée par un collectif de metteur(e)s en scène dont l’une d’elle, Carmen Luz entre en dissidence et crée la Companhia Étnica de Dança e Teatro, qui travaille avec la dramaturgie classique et avec celle du théâtre noir, et cherche un langage spécifique au théâtre noir ; la Companhia Marginal qui s’inspire des axes du travail de Solano Trindade alliant lutte de classe et lutte de race, et la Companhia dos Comuns dont le fondateur est Hilton Cobra qui a œuvré de 2001 à 2012.
A São Paulo, « les tensions raciales sont beaucoup plus intenses » constate Roger Bastide anthropologue spécialiste de sociologie et littérature brésiliennes, observant que le Teatro Experimental do Negro n’avait pas réussi à s’implanter dans la ville, malgré quelques tentatives ; une des expériences de l’après dictature fut la création de la Companhia Ori-Gen Ilê de Creação par Zenaide Silva, issue de la Companhia Étnica de Rio qui mit en scène en 1991 une version de La Tempête avec seize femmes de couleur et un parti pris philosophique spécifique pour le personnage de Caliban qui reprenait les thèmes de la négritude, la pièce connut un immense succès et tourna dans le monde ; une autre actrice et metteure en scène quasi autodidacte au départ et venant de l’Etat du Parana – qui eut l’opportunité de jouer dans Les Nègres de Jean Genêt en 1989 – Dirce Thomaz a traité de la violence subie par la femme et consolidé le statut de la femme noire actrice. Elle crée en 1995 un Centre de dramaturgie et de recherche sur la culture noire et s’installe dans un squatt artistique, Casa Amarela. Aujourd’hui, de jeunes afro-descendants pour la plupart issus de milieux universitaires ont créé des groupes de théâtre noir sous forme de collectifs ou de compagnies : ainsi le Groupe Os Crespos créé à l’initiative d’un groupe d’étudiantes de l’école d’art de l’Université de São Paulo ; As capulanas du nom du tissu porté par les femmes mozambicaines et Colectivo Negro créé en 2008 par des comédiens de l’école de théâtre Santo André. La Mostra de Teatro Negro a été créée en 2010 et permet la confrontation des expériences.
A Salvador de Bahia où d’après le dernier recensement de 2010, la population blanche est à 17,87%, la noire à 26,83%, et la mulâtre à 53,39%, Christine Douxami note que « les préjugés de couleur vis-à-vis des Afro-brésiliens font partie du quotidien. Face à cette situation d’exclusion sur fondements ethnico-sociaux, le mouvement noir bahianais s’est organisé dès les années trente, se concrétisant plus nettement dans les années soixante-dix. Or, durant cette seconde période, à la différence du reste du pays, l’affirmation du mouvement noir bahianais passe avant tout par la mise en avant de sa spécificité culturelle afro-bahianaise. » Le Teatro Experimental do Negro n’eut jamais la possibilité de se présenter à Bahia mais son influence s’est faite fortement sentir. Les déclencheurs qui ont favorisé son développement sont la création de l’Ecole de théâtre Martin Gonçalves en 1957, et l’action du Teatro Negro da Bahia créé à l’initiative de Lucia dos Santis en 1969. Nivalda Costa, élève de l’école de théâtre créait ensuite avec d’autres acteurs noirs, en 1975 en pleine dictature, le Grupo Testa, faisant passer ses messages contestataires. Elle s’intéressa au théâtre anthropologique d’Eugenio Barba, aux rituels et au syncrétisme des religions mêlant le candomblé aux spectacles. Le Grupo Palmares Iñaron Teatro Raça e Posição, rassemblant de jeunes acteurs noirs de l’Ecole de Théâtre Martin Gonçalves s’est appuyé sur le théâtre documentaire pour parler « de la race, de l’ethnie et de l’Indien » et investi dans un travail social et éducatif de formation d’acteurs. La Companhia de teatro popular do Sesi créée en 1991 par Luis Bandeira, animateur ensuite de la dissidente Cia Gente de Teatro da Bahia a collaboré avec le groupe de carnaval afro des quartiers et monté une procession spectacle en l’honneur de Iemanja, déesse de la mer. C’est une troupe de théâtre « socialement engagée envers les populations afro-brésiliennes, particulièrement celles à faibles revenus. » Le Bando de Teatro Olodum fut créée en 1990 par Marcio Mereilles, souvent critiqué car blanc, dont le travail était reconnu avant même la création de la compagnie. Il s’inscrivait dans la sensibilité de Gilberto Freyre, sociologue et écrivain brésilien qui a marqué le pays. Mereilles travaille aussi bien à partir de la dramaturgie européenne (Büchner, Heiner Müller, Brecht) qu’à travers l’univers afro-brésilien. « Je ne sais pas si je fais du théâtre noir, parce que cela voudrait dire qu’il y a du théâtre blanc, mais je sais que les thèmes que nous abordons sont liés à la population noire » dit Marcio Mereilles. Les deux compagnies les plus récentes sont nées l’une en 1998, le Nucleo Afrobrasileiro de Teatro de Alagoinhas à cent trente kilomètres de Salvador, l’autre en 2004, le Centro Abdias Nascimento ; elles travaillent dans la pluridisciplinarité et mêlent théâtre, musique et danse.
Il n’est pas simple de définir le théâtre noir, Christine Douxami en transmet les nombreuses énonciations par ceux qui le font et qui expriment eux-mêmes la difficulté de cette définition : « La présence de l’acteur noir sur scène en est l’élément constitutif », suivi de « l’aspect militant et engagé de ce théâtre… » Les acteurs définissent aussi « le public à qui se destine le théâtre noir» et disent jouer « pour le peuple ou la communauté… » Le metteur en scène et le producteur doivent, pour certains, être afro-brésiliens de même qu’une partie de l’équipe technique comme le créateur lumières et le costumier, mieux à même de traduire le discours identitaire. La collecte de la parole des artistes sur un si vaste terrain, le Brésil, semblable à un continent, est riche, et l’ouvrage, très fouillé, témoigne d’une multiplicité de rencontres et d’expériences. Il est une importante et remarquable somme de travail qui rassemble la mémoire éclatée des artistes afro-brésiliens, et donne lecture d’un parcours à une minorité longtemps reléguée aux rôles de second plan. Les compagnies de théâtre noir naissent – comme de nombreuses autres compagnies – par scissiparité, à partir de la dissidence et tablent sur le développement du collectif, se sentant vite à l’étroit quand un leader impose ses points de vue.
Brigitte Rémer, 20 avril 2016
Christine Douxami est artiste-chercheuse et anthropologue à l’Institut des mondes africains, associée au laboratoire Elliadd. Elle est Maître de Conférences en Arts du Spectacle à l’Université de Franche- Comté, et a à son actif plusieurs publications. Cet ouvrage est publié aux éditions de L’Harmattan, Collection Logiques sociales, Paris, 2015.