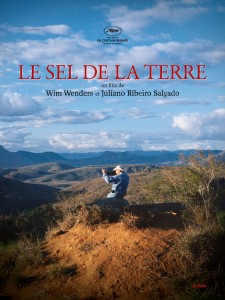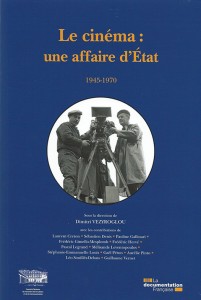Texte et mise en scène de Jean-René Lemoine. Spectacle présenté par la MC93 hors les murs dans le cadre du programme Le Standard Idéal.
C’est un texte magnifique et osé, parfois très cru, si bien porté par l’auteur-acteur-récitant, seul en scène et incarnant Médée, qu’on en reste ébahi et glacé, par le mystère de la théâtralité. Médée-Matériau d’Heiner Muller revu par Anatoli Vassiliev a inspiré Jean-René Lemoine, qui en écrit sa version comme un opéra parlé, en trois mouvements et re-dessine le mythe, tout en le restituant. Sa force se résume en son titre : Médée, poème enragé. « Mes amies… » lance l’acteur au spectateur, dans le Prologue, le prenant à témoin.
Le premier mouvement, Genèse, brave les tabous de l’inceste entre Médée et son frère, Apsyrte, qu’elle exécute comme une mante religieuse quand le navire Argo pointe dans l’horizon, avec, à son bord, Jason tant attendu et sa Toison. L’oubli et la remémoration, rewind dans le texte, transcendent le quotidien dans un récit troublé, entre passé et présent. Et Médée brave son père, figure d’un commandeur sanguinaire qui « tue les étrangers abordant son pays », et oblige à la fuite du couple pour Iolcos, le pays de Jason : « Médée, je te prends pour épouse ».
On entre dans le second mouvement, Exil, avec les deux enfants nés de l’union, leur joie de vivre et leurs jeux d’eau contrastant avec les sombres pensées de Médée, princesse déjà délaissée : « Allez trouver Jason, dites-lui de revenir, je ne peux plus voir le soleil, dites-lui qu’il ne doit pas me laisser seule ». Le récit du meurtre à venir est calme et terrible, et les mots en demi brume introduisent le cauchemar : « Je vais me lever, me mettre nue, glisser dans la piscine, les serrer contre moi, sentir leur vie, je vais nager avec eux, les laisser arriver en premier à l’autre bout de la piscine et les regarder, triomphants, m’accueillir en vainqueurs. Je ferme les yeux, j’entends leurs cris d’oiseaux. Quand j’ouvrirai les yeux, ils auront disparu ».
La fuite reprend, l’errance, l’exil et la folie. « Nous avons erré de ville en ville. J’ai accouché dans des hôtels. Fait, défait, refait les valises. Allaité mes enfants sur le bord de la route. Contemplé cent couchers de soleil. Appris toutes les langues du monde. Mon visage est intact mais je n’ai plus d’âge. Des ombres glissent sur les yeux de Jason. Je connais sa fatigue. Moi je suis forte. Immortelle ». Arrivés à Corinthe, Créon les accueille dans le luxe de son immense villa, et tout se délite. Pour garder Jason, Médée accepte tout : viol, trahison, mensonge et même rupture, et jusqu’aux épousailles de Jason avec Creüse, fille de Créon.
Et la vengeance se met en place, froide et volcanique, transformant Médée en « infanticide amoureuse », en meurtrière accomplissant la terrible prédiction : « Pas un souffle. Je fais quelques longueurs. L’eau est douce et souple comme un lac. J’arrête de penser. Je suis bien ». La mort des enfants ne suffisant pas, Médée poursuit sa fuite en avant et officie dans un autre meurtre, de manière violente et cérémonielle, tendant un piège à la nouvelle épousée de Jason. Incantations de folie.
Le troisième mouvement, Retour, témoigne de la traversée de Médée, rentrant seule au pays où elle est désormais devenue étrangère : « Je retourne à l’inconscience, à l’état d’avant la vie »; sa mère s’est jetée du haut de la tour à la mort du fils, elle accompagne l’agonie du père. Sa folie, ses visions l’habitent jusque dans l’Epilogue : « J’ai continué ma route jusqu’à l’océan. J’ai aperçu Jason qui marchait au loin sur le rivage, avec nos deux enfants. Et j’ai pensé, ils sont ensemble, tout va bien, et ils se promènent sous la neige ».
Assisté pour la mise en scène de Zelda Soussan, Jean-René Lemoine restitue avec une infinie douceur la force poétique du texte, plongeant le spectateur dans l’incandescence du mythe. Seul face au micro et dans une grande intensité, il est le récit et sa sensibilité à vif prend le contre pied de la puissance d’un texte qu’il cisèle, du chuchotement au cri : « Qu’ai-je fait d’autre que d’aimer celui qui ne m’a pas aimée » ? Le créateur musical et sonore, Romain Kronenberg, dans l’ombre côté cour, rythme quelques moments tout aussi subtilement, portant l’acteur-actrice comme une reine déchue, torse drapé d’un satin magnifiquement fluide et ambigu (costumes de Bouchra Jarrar). L’écriture de lumières joue de contre-jours et renforce la magie (création de Dominique Bruguière), et deux pleins feux traversent comme des éclairs, lors des moments de transition, l’aire de jeu, rectangle recouvert d’un tapis noir cerclé d’un filet de sable (dispositif scénique, de Christophe Ouvrard).
Dramaturge, metteur en scène et acteur né en Haïti, formé au Conservatoire d’Art Dramatique de Paris et à l’école Mudra de Maurice Béjart à Bruxelles, Jean-René Lemoine se consacre à l’écriture dramatique à partir de 1985, et à la mise en scène : Iphigénie, Portrait d’un couple, Chimères, L’Ode à Scarlett O’Hara, Ecchymose, L’Odeur du noir, Le Voyage vers Grand-Rivière sont ses principales pièces, Erzuli Dahomey, déesse de l’amour, reçoit le prix de la SACD en 2009 (en dramaturgie de langue française) et entre au répertoire de la Comédie Française, en 2012.
Avec Médée poème enragé, il côtoie les hauts sommets, comme auteur, acteur et metteur en scène. Sa grande maîtrise et parfaite retenue, nous plongent dans le trouble et au cœur de la tragédie antique, de la blessure à la vengeance : « Jusqu’à la tombe, Jason, tu m’appartiens ». Ses Ellipses écrites dans le texte, induisent les blancs de la chronologie tout autant que les passages à vide et courts circuits, dans la psyché de l’étrange étrangère : « Je ne sais plus, j’ai oublié»… Et dans l’excès et le déchirement de ses passions, la mythique Médée, d’Euripide à Pasolini et de Sénèque à Christa Woolf, sous la plume sensible de Jean-René Lemoine, interroge encore l’aujourd’hui : « Médée poème enragé raconte ce que je suis et parle des ambiguïtés, celles d’être façonné par des terres différentes, celles de la masculinité et de la féminité ».
brigitte rémer
Avec : Jean-René Lemoine et Romain Kronenberg – Collaboration artistique : Damien Manivel – Assistant lumières : François Menou – Assistante à la mise en scène : Zelda Soussan – Maquillage : Marielle Loubet. Le texte de Jean-René Lemoine est publié aux Editions Les Solitaires intempestifs.
Théâtre Gérard Philipe CDN de Saint-Denis, du 27 mars au 3 avril 2015 – Spectacle vu à la MC93 de Bobigny en mars 2014 lors de sa création. Cet article a été publié par Théâtre cultures.