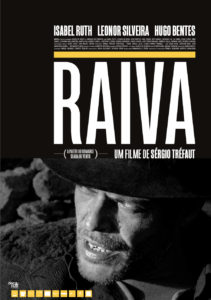d’après La Préparation du roman de Roland Barthes, version scénique et mise en scène Sylvain Maurice, avec Vincent Dissez – à L’Échangeur Théâtre de Bagnolet.
C’est un texte sublime d’intelligence et de vie, émaillé de nombreuses références comme autant d’évidences. Nous sommes au Collège de France dans le cadre du séminaire que donnait Roland Barthes le samedi matin en 1979 et 1980, il y occupait la chaire de sémiologie littéraire après avoir été directeur d’études à l’École pratique des hautes études.
Barthes (1915-1980) est en fin de parcours, il ne le sait pas. Sociologue, philosophe, sémiologue, critique littéraire, écrivain, il échappe à toutes les catégories, et s’il est bien ancré dans l’histoire contemporaine du XXème siècle il est un libre penseur, amoureux de la littérature, du théâtre et des mots, amoureux de l’amour, amoureux de la vie.
La séance qui s’annonce, élaborée par le metteur en scène, Sylvain Maurice qui en signe une adaptation probablement difficile à réaliser tant le matériau d’écriture est riche – sept cents pages – magnifiquement portée au plateau par Vincent Dissez, traite de La préparation du roman. Le discours est adressé, prenant le public devenu l’audience du samedi matin à témoin. On est dans l’oralité et si Barthes a incontestablement préparé son cours, il nous mène, par ce texte, de digression en digression, toutes aussi pertinentes et imagées les unes que les autres. Barthes finalement se parle à lui-même, à voix haute, s’interrogeant sur l’écriture, qui est sa vie, et se regarde dans cette quête passionnée, avec une grande simplicité. Il se livre, à mains nues, son cerveau et son stylo pour seuls outils, dans un dénuement quasi monacal.
Faire le vide et ne se remplir que des mots des autres pour les ressentir, les analyser, les ingérer et les faire siens, de Dante Alighieri à Flaubert, Proust, Maupassant, Rousseau et quelques autres en compagnonnage et dans la permanence de la pensée, telle est la démarche de Barthes. Il parle de l’état dépressif du deuil, comme d’un désinvestissement général et d’une perte de sens, ce qu’il est en train de vivre après la mort de sa mère. Il s’arrête sur ce midi de la vie, qu’il nomme le « milieu du chemin de la vie » s’inspirant de Dante, dans sa Vita Nova à la recherche d’un déclencheur qui permette de se réinventer et se réinvestir, en changeant radicalement de cap, où que nous en soyons du temps t de la vie . Il est à la recherche d’une sorte de conversion littéraire, dans la jouissance et le plaisir d’écrire, dans « l’idée d’entrer en littérature, d’entrer en écriture, l’idée d’écrire comme si je ne l’avais jamais fait, et de ne plus faire que cela. » Ce cours aurait pu s’appeler comme si, précise-t-il.
Sur une estrade à peine surélevée, grand rectangle blanc où se trouve un bureau blanc, une chaise orange et quelques objets que l’acteur déplacera à peine, l’homme est dans sa réflexion et dans un jeu de mains qui dessine parfois les mots ou rebat les cartes. Tout est mesuré, maîtrisé. Vincent Dissez cisèle le moindre geste, le moindre pas, réalisés avec une précision et une justesse, infinies. La lumière, sobre, permet à un certain moment un jeu d’ombres de chaque côté du plateau, Barthes est entouré de lui-même et dans une certaine solitude, sans aucun ego avancé alors qu’il est une star intellectuelle connue du monde entier (lumière Rodolphe Martin).
Car Barthes n’est pas un faiseur de concepts ni une machine aux mots ampoulés, c’est un homme délicat et sensible, parfois gentiment sarcastique et plein d’humour qui puise ses exemples dans la vie et se passionne pour celle des autres. Ainsi la petite couturière à domicile dont il parle et qui l’illumine par la précision de ses gestes et par sa modestie. Quand il réfléchit à l’écriture et qu’il se demande pourquoi il écrit – alibi, plaisir… – il met le projecteur sur le remaillage des bas et le geste qui appuie sur le bas pour qu’il ne file pas, et propose de poser un doigt sur ses imaginaires comme les femmes de l’époque pour stopper la maille qui file… Il file donc la métaphore avec habileté passant de l’une à l’autre dans un humour tendrement diabolique, il aime la digression, son paysage intérieur est riche et multiple.
À côté des images qu’il utilise il parle aussi de la vieillesse et reprend l’idée de rupture, car « la continuité n’est pas acte de vitalité » dit-il et si le présent est vivant pour lui, l’actuel ne l’est pas. Il développe l’idée de rupture libératrice nécessaire à l’écrivain pour se retirer du monde et trouver son espace hors de tout bruissement, de la nécessité de « disparaître, du moins provisoirement. » Et il livre ses stratégies de la disparition, à savoir « rester dans une immobilité entêtée » ou « imposer au monde qu’on est un original » ou encore « être malade » et il prend à partie Flaubert et Proust. Il évoque aussi la table de travail, comme une sorte de nautilus où se trouvent ce qu’il nomme « les objets fondateurs » qu’il oppose à la notion d’ordre. On ne touche pas à la structure, vitale et transportable. Puis il se lance dans l’exemple de la mayonnaise, ratée ou réussie et de l’image du jardinier ensemençant, ou plus précisément de la technique du marcottage utilisée en horticulture.
Le bureau est sorti de l’estrade, sorti du tableau, il s’y assied quelques instants et un grand rectangle de lumière bleue s’affiche sur le mur, en fond de scène. Il parle de rectangle imaginaire et de l’ordre des mots, Mallarmé reliant les siens après les avoir posés dans un certain désordre, Proust les juxtaposant. « Nous qui aimons la littérature sommes des exilés sociaux » dit-t-il en dispersant ses objets familiers sur le tapis de scène blanc, qui se teinte aussi de bleu. Une bande son avec quelques notes de piano, les bruits d’une cour de récréation et à peine la rumeur de la vie comme les touches de la machine à écrire, structure la représentation (son Jean de Alméida). Le spectacle se termine sur « la spirale » du compositeur et théoricien Schoenberg, Barthes propose d’écrire son prochain livre en do majeur.
Le Projet Barthes, par sa recherche de sens, soigne notre monde envolé. Par sa « pensée au présent » l’auteur partage ses Mythologies, son Aventure sémiologique et la synthèse de toute son œuvre. Le partenariat artistique qui s’est noué entre le metteur en scène Sylvain Maurice et l’acteur, Vincent Dissez, se poursuit autour de solos d’une grande force et avec tout autant de grâce et de travail que l’étaient les spectacles Réparer les vivants, roman et hymne à la vie de Maylis de Kérangal, et Un jour je reviendrai, réalisé à partir de deux récits autobiographiques de Jean-Luc Lagarce. Ce travail est d’orfèvrerie, porter le texte de Barthes à la scène, une gageure, dans le bruissement de sa langue… Et tant que la langue vivra… !
Brigitte Rémer, le 12 mars 2026
D’après La Préparation du roman de Roland Barthes version scénique et mise en scène Sylvain Maurice avec Vincent Dissez – lumière Rodolphe Martin – son Jean de Alméida – régie Daniel Ferreira – production compagnie [Titre Provisoire] en coréalisation avec L’Échangeur de Bagnolet. La compagnie [Titre Provisoire] est soutenue par le ministère de la Culture/DRAC Bretagne. La Préparation du roman est publié aux éditions du Seuil. Voir aussi (https://www.xn--ubiquit-cultures-hqb.fr/reparer-les-vivants/ ) du 4 juillet 2017
Création du 11 au 21 mars 2026, à l’Échangeur Théâtre de Bagnolet, 59 avenue du Général de Gaulle, 93170. Bagnolet, tél. : 01 43 62 71 20, métro : Galliéni – site : www. : lechangeur.org et www. sylvainmaurice.fr