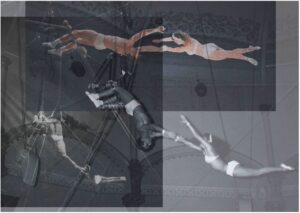Basile Behna a déserté Alexandrie et la vie, le 2 mai 2024. Famille, amis et amoureux du cinéma lui ont rendu hommage en septembre dernier, à l’Institut du Monde arabe, à Paris.
Au programme de ce moment ardent et chaleureux, des témoignages, des chants lyriques de sa fille, la soprano Dounia Behna, accompagnée par Agnès Bonjean au piano – Ravel, Mozart, Bizet et Kurt Weill, la projection de films d’animation des Frères Frenkel, des films de Gaëtan Trovato, des extraits filmés d’un ciné-concert de 1959 autour du Voyage sur la lune de Hamada Abdel Wahab, la projection du film La Chanson du cœur (Ounshoudat al Fouad) de Mario Volpe.
Basile Behna est plutôt un homme de l’ombre qui a œuvré toute sa vie à la préservation et la valorisation du patrimoine cinématographique égyptien, un taciturne dont le visage s’éclairait quand il parlait des arts, notamment visuels et audiovisuels, ainsi que de la musique. Il appartient à une famille emblématique de l’âge d’or du cinéma égyptien. Né à Alexandrie en 1955, sa mère est libanaise, son père d’origine syrienne, arrivé en Égypte à l’âge de trois ans, Basile baigne dès l’enfance dans le milieu du cinéma. L’entreprise familiale florissante de production cinématographique, Sélections Behna Films, développée à partir de la fortune familiale constituée par l’oncle Rachid le patriarche, dans le commerce du tabac. Créée par son père et son oncle, Georges et Michael Behna, pour allier réussite matérielle et réussite sociale, elle est l’un des principaux acteurs du cinéma, de 1930 à 1950,

L’histoire de la famille Behna est une belle histoire d’Alexandrie mêlée à l’histoire du cinéma, qui a débuté en 1896 par la projection du film des Frères Lumière, L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat, à la Bourse Toussoun Pacha. Ce fut la première projection d’un film en Égypte et signe précurseur de l’inauguration, un an plus tard, de la première salle de cinéma du pays, nommée le Cinématographe Lumière. Magda Wassef, qui fut directrice du Département Cinéma à l’IMA le raconte magnifiquement dans son ouvrage, Égypte, cent ans de cinéma.
C’est dans une Alexandrie cosmopolite et moderne que les frères Behna se lancent dans l’industrie cinématographique, dans les années 1920, d’abord en important des films de Charlie Chaplin et Laurel et Hardy qu’ils sous-titrent ou doublent, puis des films de France et de divers pays. En 1932, ils coproduisent et distribuent avec les frères Nahas le premier film musical égyptien, Ounshoudat Al-Fouad (La Chanson du cœur) – qui sera projeté au cours de la soirée – et deviennent l’un des principaux distributeurs de films égyptiens dans le monde arabe et en France. « Ma famille était composée de marchands d’Alep, originaires de Mossoul en Irak, et est arrivée en Égypte aux alentours du début du XXe siècle », déclarait-il dans un entretien avec Rowan el Shimi, pour Al-Ahram on line, le 30 janvier 2013. Ils avaient fait fortune dans le commerce du tabac mais avaient très vite choisi d’investir dans le cinéma. Après l’importation des premiers films, ils produisent des courts métrages – comme Awlad Akef, Siwa, Fantasia Arabia et ont été les premiers à produire un film d’animation des Frères Frenkel. Ils créent une société de production et de distribution cinématographique, Behna Film Company, et produisent l’un des tout premiers films parlants, Ounshoudat Al-Fouad, La Chanson du coeur.
Le film ne remporta pas le succès escompté mais ouvrit la voie aux nombreux films musicaux qui seront réalisés par la suite et jusque dans les années 60, un genre en soi. Les frères Behna abandonnèrent alors la production pour fonder la première société de distribution de leurs films en Orient, Sélection Behna Films. Ils la développèrent au fil des années et ouvrirent avec succès des bureaux à Khartoum, Bagdad, Beyrouth, Damas et partout au Moyen-Orient. Ils aimaient à s’entourer de nombreux artistes comme le compositeur et chanteur Mohamed Fawzy et l’actrice Madiha Youssry, le célèbre acteur Ismail Yassin, le réalisateur-phare et producteur Togo Misrahi, réalisateur entre autres de Sallama avec Oum Kalthoum. Les Frères Behna ont marqué de leur empreinte le cinéma égyptien.
En 1961 pourtant leur activité se suspend, Sélections Behna Films étant nationalisée par la politique socialiste du Président Gamal Abdel Nasser et soumise au régime de la séquestration. La famille Behna quitte l’Égypte pour le Liban, en 1964 mais fait de nombreux allers-retours à Alexandrie. Basile, parfaitement francophone et francophile, fait des études en sciences économiques à Paris à partir de 1976, vit un temps en Afrique, mais, amoureux de sa ville, s’installe définitivement à Alexandrie, en 1997. Il se consacre alors, avec sa sœur Marie-Claude – qui fut déléguée adjointe de la Biennale des cinémas arabes à l’IMA – à la restitution légale du patrimoine familial. Ils finiront par obtenir gain de cause dans les années 2010 et récupèrent les archives cinématographiques de la famille, abandonnées et en mauvais état, ainsi que les droits de la société ; ils décident de restaurer le siège de Behna Film.
« Dans la famille, les soirs de télévision étaient une fête » disait Basile. Sa famille le raconte, dans l’ambiance d’Alexandrie avec petits et grands écrans, sa sœur, Marie-Claude Behna, Dounia, sa fille et Cléa Behna, architecte. « Basile avait l’âme et la passion d’un collectionneur, l’âme d’un passeur » disent-elles. « Il aimait les artistes, les écrivains, les marginaux et se plaisait à transmettre. » Son appartement d’Alexandrie était un vrai musée.
Au fil de cette soirée hommage à Basile Behna et au cinéma égyptien, s’entremêlent divers extraits et projections, entre autres deux films publicitaires des Frères Frenkel, Mafish Fayda, (1936) et Le Secret du bonheur, (1947). Pionniers du cinéma d’animation en Égypte, les Frenkel créent le très populaire personnage de Mish Mish Effendi, apparu dès 1936 sur un écran cairote ; des films documentaires de Gaëtan Trovato, jeune réalisateur diplômé de l’Ecole supérieure d’art d’Aix-en-Provence qui a rencontré Basile Behna – Avant que j’oublie, (2016) Les Sels d’argent, et Tu me diras ce que tu as vu, de 2022 ; des extraits filmés d’un ciné-concert autour de Voyage sur la lune de Hamada Abdel Wahab datant de 1959, créé par le pianiste et compositeur Emmanuel Denis, accompagné à la batterie par David Guil, filmé par Camille Berthelin.
Un reportage sur le lieu qu’a créé Basile Behna après récupération de Behna Film, lieu historique de Manshiya, au cœur d’Alexandrie, pour en faire un lieu dédié aux arts visuels et aux cinéastes indépendants. Wekalet Behna a réouvert en janvier 2013, après plusieurs mois de restauration avec l’aide de bénévoles locaux et internationaux, sous la supervision et vigilance d’Aliaa El-Gready, artiste plasticienne et cofondatrice de Gudran, association qui œuvre dans l’espace public d’Alexandrie depuis plus d’une vingtaine d’année. Omayma Abdel Shafy, entrepreneuse culturelle le gère, on y trouve les archives liées aux films produits et gérés par Sélections Behna Films, dont de nombreux documents iconographiques, des publicités, des affiches et beaucoup d’autres imprimés.
La projection du long métrage de Mario Volpe, ferme cette longue et belle soirée, Chanson du cœur (Ounshoudat al Fouad / أونشودات الفؤاد, tourné en 1932 sur pellicule en nitrate de cellulose, pour une partie aux studios Éclair de Paris, et retrouvé avec difficulté par Basile et Marie-Claude Behna, les a menés à la Cinémathèque française. Une copie du film y avait été sauvegardée et la Cinémathèque a restauré numériquement le film, en son et en image, en 2012. Ce film se trouve au carrefour du cinéma muet et du cinéma parlant, avec les plans silencieux et cartons explicatifs du premier, les scènes parlées et chantées du second, dans une distribution lumineuse : la célèbre chanteuse Nadra, le grand chanteur et compositeur Zakaria Ahmed qui en signe la bande-son, et des acteurs-vedettes issus du théâtre, comme Georges Abiad, Dawlat Abiad, Abdel Rahman Roshdi.
Basile Behna, était un amateur d’art raffiné et convaincu que la culture est la clé d’un véritable changement social. Généreux, il savait ouvrir sa porte pour prêter des bribes de cette mémoire individuelle et la transformer en mémoire collective. Ainsi l’Institut Français d’Alexandrie où je me trouvais en tant que directrice adjointe avait pu présenter en 2007 une belle exposition à partir des documents, photographies et affiches prêtées par Basile. Un grand moment qui affichait sur les murs de la splendide villa italienne qu’est l’Institut les Portraits des Pionnières du Cinéma Égyptien – Badia Massabni, Aziza Amir, Assia Dagher, Amina Rizk, Laïla Mourad, Mary Queeny, Madiha Yousri… une longue liste de ces divas qui ont été les merveilleuses actrices des années 1930 à 1950, également souvent réalisatrices et productrices. Nos remerciements pour le partage, à Basile Behna et longue vie à Wekalet Behna.
Brigitte Rémer, le 3 janvier 2026
Hommage à Basile Behna rendu le 26 septembre à 19h, à l’Institut du Monde Arabe de Paris, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, Place Mohammed V. 75005. Paris – métro Jussieu et Cardinal Leùoine – site : imarabe.org – tél. : +33 (0) 1 40 5138 38.